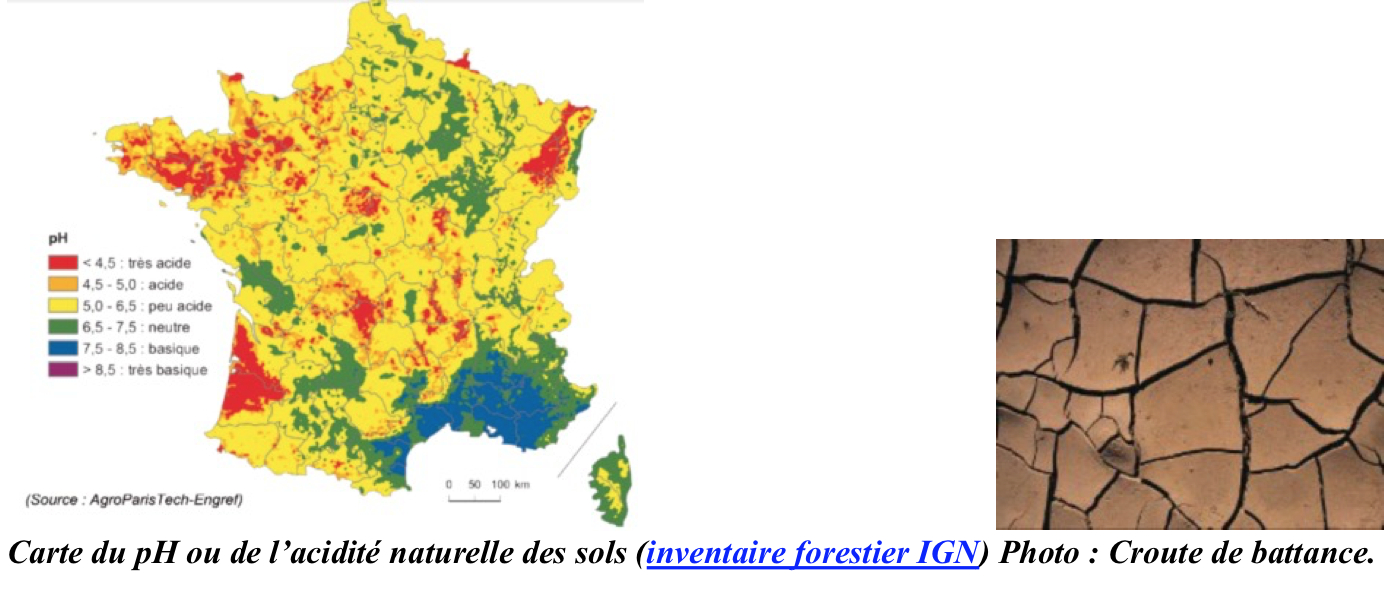DURABILITE DES PRATIQUES AGRICOLES
12 février 2018
Rédacteurs :
Daniel BLOC
Hubert BOUCHET
Bernard CURE
Bernard GAILLARD
Virginie LAFFON
Gilles LAUDREN
Joseph MARCHADIER
Alain MOUREAUD
Jean PAVIOT
Jean Paul PREVOT
Dossier coordonné par Bernard CURE
Le document suivant existe également sous forme de diaporama.
Sommaire
Préambule
1. La durabilité : définition, approches et interprétations
1.1. Définition et application à l’environnement naturel
1.2. La durabilité : une pluralité d’approches et d’interprétations
1.3. La durabilité : vue par les producteurs agricoles vs consommateurs
1.4. Durabilité et productivité
Encadré 1
: Durabilité et surfaces consacrées à l’agriculture – Evolution de la forêt française depuis le 19ème siècle
Encadré 2
: Durabilité et économie
2. Energie et durabilité de l’agriculture
2.1. Des énergies plus rares et plus chères ?
2.2. Energies renouvelables, un atout ?
2.3. Energies agricoles renouvelables mais non intermittentes
2.3.1. Biocarburants
2.3.2. Méthanisation
2.4. Réduire la consommation d’énergie des exploitations agricoles
2.5. Maîtriser les gaz à effet de serre (GES)
2.5.1 Stratégies d’atténuation
2.5.2 Stratégies de séquestration
2.5.3 Stratégie d’adaptation
2.6. Conclusions
3. Le sol : un des éléments patrimonial clé de la durabilité
3.1. Préambule et définitions
3.2. En agriculture la durabilité des techniques culturales n’a jamais existé
3.3. Les sols agricoles se sont formés il y a très longtemps et sont toujours en évolution.
3.4. Le plus grand danger pour les sols : leur « artificialisation » liée au contexte socio-économique
3.5. Le second risque pour le sol est celui de l’érosion.
3.6. Le tassement des sols peut engendrer des baisses de fertilité
3.7. L’assimilation des éléments minéraux dans la solution du sol provoque inexorablement une lente acidification des sols.
3.8. Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle
3.9. La pollution des sols peut être localement préoccupante au niveau de la parcelle
3.10. Le travail du sol trouve son origine dans la domestication des plantes
3.11. Les objectifs du labour sont multiples et s’appuient sur le climat pour la fonction d’ameublissement.
3.12. La vie biologique qui découle du développement des plantes contribue à la fertilité des sols.
3.13. Les plantes peuvent s’enraciner bien au-delà de la zone travaillée du sol.
3.14. Les rendements élevés ne réduisent pas la fertilité des sols, au contraire ils tendent à l’améliorer.
3.15. La simplification des rotations
3.16. La gestion des bords de parcelles
3.17. Indicateurs de la durabilité des sols ?
3.18. Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle en France dans les zones de grandes cultures.
4. La gestion de l’eau pour l’irrigation procède-t-elle d’une démarche durable ?
4.1. Les enjeux
4.1.1. Exemple du bassin versant de la Charente
4.1.2. Exemple de la nappe de Beauce
4.2. Moyens mis en œuvre pour assurer la durabilité
4.2.1. Gestion collective
4.2.2. Echelle individuelle
4.3. La gestion de l’eau pour l’irrigation est-elle durable ?
4.3.1. Des ressources bien supérieures aux besoins.
4.3.2. La durabilité des prélèvements dépend du type de ressources
4.3.3. Une volonté commune des différents utilisateurs
4.3.4. Des progrès significatifs et constants dans la gestion de l’eau au niveau individuel.
4.3.5. Mais l’irrigation est coûteuse en énergie
4.4. Conclusion : les défis à venir
Encadré 3: Eaux supericielles et eaux profondes
Encadré 4
: Une France qui s'assèche
5. Les pesticides : incontournables dans la nécessaire protection des cultures
5.1. Pas de durabilité sans protection des cultures
Encadré 5
: l’utilisation des biopesticides est-elle plus durable ?
5.2. De la protection raisonnée à la protection intégrée
5.2.1. La rotation des cultures
5.2.2. Labour, travail superficiel ou non travail du sol ?
5.2.3. L’agriculture de conservation
5.2.4. La gestion de résistances
5.3. Le biocontrôle
5.3.1. Une tentative de définition
5.3.2. Les différents outils du biocontrôle
5.3.3. Espoirs et freins du biocontrôle
5.3.4. Le biocontrôle, un mariage de raison avec les outils conventionnels
Encadré 6
: les produits de protection des plantes de demain
5.4. L’indispensable levier génétique pour une durabilité de tous les systèmes de production
5.4.1. La création de variétés résistantes au parasitisme, arme n°1 du biocontrôle
5.4.2. Des OGM partout dans le monde, mais pas en France
5.4.3. Les NBT (New Breeding Techniques), l’« Edition de gènes » et le système CRISPR/Cas9
Encadré 7
: une question de réglementation cruciale pour les agriculteurs
5.5. Conclusion : Pas de durabilité ni de protection des cultures efficace sans une utilisation diversifiée et
simultanée de tous les moyens de lutte
Encadré 8
: biodiversité et durabilité
Encadré 9
: Désinformation complète du grand public par la presse
Préambule
Avant que l’on ne parle de durabilité, c’est la disponibilité qui préoccupait nos anciens. La nature parcimonieuse mobilisait toute leur énergie pour récolter ce qu’elle produisait. Il n’était pas question de durabilité, mais de lutte pour ne pas manquer.
« A cheval donné, on ne regarde pas la dent ». Cette maxime caractérise la posture induite par la situation alors dominée par le risque de manquer.
De surcroît, le règne de la cueillette directe de ce que la nature octroyait imposait une passivité causée par la stabilité ancestrale des rendements. Le concept de durabilité n’avait pas lieu d’être dès lors que la production était sous l’empire de l’aléatoire.
Les derniers siècles ont vu rebattre les cartes. Le risque de manquer s’est estompé à la faveur de l’explosion des capacités productives, caractérisée par une meilleure maîtrise des techniques de production. Celles-ci sont progressivement passées sous l’empire de la connaissance scientifique assurant une maîtrise croissante des facteurs de production, par le recul de l’aléatoire.
La fin de la faim s’est accompagnée de la rupture du lien direct et ancestral entre le producteur et le consommateur. Désormais, ce lien n’est plus direct et la confiance qui allait de soi a fait place à une défiance justiciable de comportements protecteurs. Le double principe de la durabilité et de la précaution procède de ces comportements.
La précaution a pris place dans la constitution de la République. Le large spectre que couvre le terme en fait la fortune. Il nourrit la polémique dès lors qu’il peut être invoqué sans vergogne, ni retenue. Alimenté du seul ressenti, le principe de précaution peut avoir des effets délétères qu’un souci de discernement minimal disqualifierait.
Pareillement polysémique, le terme de durabilité se traduit dans toutes les acceptions. Au dictionnaire, les antonymes de durabilité répertoriés sont au nombre de deux : volatilité, instabilité tandis que les synonymes, eux, sont six : pérennité, viabilité, continuité, permanence, longévité, constance.
A l’instar du principe de précaution, l’exigence de durabilité peut être quasi universellement invoquée. L’inventivité croissante de l’homme ne cesse de produire du nouveau, posant la question du sens de la durabilité.
C’est parce que le ressenti l’emporte souvent sur le discernement qu’il importe d’éclairer les tenants et aboutissants des pratiques agricoles à la lumière des exigences contemporaines de durabilité
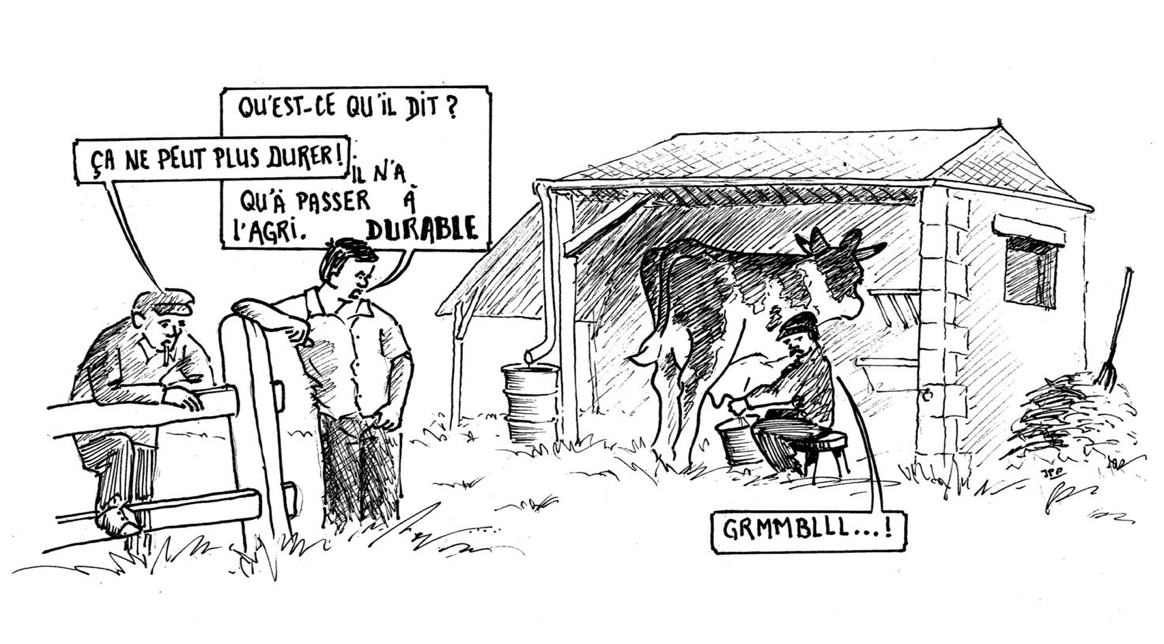
1. LA DURABILITE : DEFINITION, APPROCHES, INTERPRETATIONS…
|
Résumé Le souci que les sociétés humaines portent à la pérennité des ressources naturelles a pris une ampleur inconnue jusqu’à présent. La notion de durabilité, conjointement à celle de « développement durable » auquel elle est associée, a envahi le paysage. Dans son acceptation la plus répandue, la durabilité – certains lui préfèrent le terme de soutenabilité (de l’anglais sustainability) - est définie comme un développement s’appuyant sur trois piliers distincts : environnement, société et économie. Pour être « durable », le développement doit rechercher un équilibre entre ces trois sphères. Force est de constater que la façon de définir et d’appréhender le développement durable ne fait pas l’unanimité, certains privilégiant l’une de ces dimensions par rapport aux autres. Qu’en est-il dans le domaine agricole ? Une étude internationale, portant sur la vision de l’agriculture durable par les agriculteurs et les consommateurs, montre que ces deux groupes ne la conçoivent pas de la même façon. Si tous se déclarent préoccupés par la question, ils témoignent d’une compréhension bien différente de la notion d’agriculture durable. Alors que les agriculteurs envisagent la durabilité de façon pragmatique, comme une question multidimensionnelle, dépendante d’éléments concrets, les consommateurs la définissent dans un contexte principalement environnemental. Cette différence de vision s’explique en partie du fait que les consommateurs ont perdu les liens qu’ils entretenaient avec l’univers agricole dont ils n’ont plus qu’une appréhension déformée et réductrice. En revanche, la fonction nourricière de l’agriculture fait l’objet, quant à elle, d’une vision partagée par les deux groupes. Si, comme le prévoient les projections démographiques, la planète est appelée à nourrir 9 milliards d’individus en 2050, ce n’est qu’en conjuguant productivité et durabilité que ce challenge pourra être atteint ; l’augmentation de la productivité dans les pays développés reposant principalement sur l’innovation. Enfin, toute réflexion sur la durabilité des systèmes agricoles doit tenir compte de l’impact du contexte économique, notamment de la PAC actuelle et à venir, comme de la croissance démographique mondiale.
|
1.1 Définition et application à l’environnement naturel
Si l’on s’en réfère au dictionnaire, la durabilité est définie comme étant :
- la qualité de ce qui dure longtemps, qui s’inscrit dans le temps,
- en matière de droit : la période d’utilisation d’un bien,
- et dans le domaine de la sûreté de fonctionnement : l’aptitude d’un bien à satisfaire une fonction jusqu’à un certain état limite, autrement dit la solidité d’un bien ou d’un équipement (vs obsolescence)
La durabilité est aujourd’hui une qualité attribuée à un nombre grandissant d’objets, de choses, voire d’états... Tout ce qui est lié à l’environnement, l’écologie, la manière de vivre de façon responsable en société et le souci de l’avenir peut être regroupé sous cette notion. Tout est
« durable » ou aspire à l’être : l’habitat, l’entreprise, l’alimentation …
La préoccupation des sociétés humaines quant à la nécessité de préserver les ressources naturelles au profit des générations suivantes n’est pas nouvelle.
Citons, à ce propos, le souci exprimé par l’ordonnance de Brunoy de 1346 (!). Edictée par Philippe VI de Valois, elle énonce que « les maîtres des eaux et forêts enquerront et visiteront toutes les forez et les bois et feront les ventes qui y sont en regard de ce que lesdites forez se puissent perpétuellement soustenir en bon estat ». (1)
Plus près de nous, ce sont les économistes qui les premiers se sont saisis de la notion de durabilité, notamment à la suite du premier rapport du Club de Rome en 1972, le rapport Meadows – du nom de l’un de ses auteurs, intitulé The limits to growth (Halte à la croissance). Ce rapport est l’un des premiers à poser la question des limites des ressources naturelles (2).
Le terme de durabilité appliqué à l’environnement naturel s’impose peu à peu à partir des années 90 avec l’émergence du terme « développement durable », traduction de l’anglais sustainable development . Ce dernier fait son apparition dans le rapport issu des travaux de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement des Nations Unies en 1987, qui prendra le nom de sa présidente, la norvégienne Gro Harlem Brundtland.
Dans ce rapport, intitulé Our Common Future (Notre avenir à tous), l’accent est mis sur les besoins, notamment ceux des plus démunis, et sur le fait que les problèmes de durabilité écologique et de développement humain ne peuvent être dissociés.
La durabilité (sustainability) y est définie comme un "développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins." (3)
Ce qui est énoncé ici clairement et simplement est en fait infiniment plus complexe qu’on ne l’imagine. Notamment lorsque l’on essaie de qualifier la notion de générations futures, plus particulièrement en ce qui concerne le volet démographique et l’allure de la courbe d’évolution de la population mondiale. Par ailleurs, que savons-nous des besoins des générations futures puisque, par définition, elles ne peuvent exprimer leur point de vue….
Les sommets de la Terre (Rio en 1992, Johannesburg en 2002, Rio+20 en 2012), les rapports successifs du GIEC (plus particulièrement celui de 2007) et les différentes COP vont favoriser la diffusion des problématiques environnementales. Ces dernières amplement reprises par les médias, pas toujours de façon exhaustive, parfois tronquées ou même déformées, contribueront à mettre la question du climat sur le devant de la scène.
1.2 Durabilité : une pluralité d’approches et d’interprétations
Au fil du temps, différentes approches de la durabilité vont se dessiner :
- l’approche de durabilité faible place l’économie au centre des préoccupations (point de vue des économistes libéraux qui n’intègrent pas le capital naturel dans leurs calculs, ce dernier étant remplacé par le développement du capital technique). Les biens comme l’air, l’eau, la terre sont envisagés sous l’angle des services qu’ils rendent à l’homme. Cette conception faible de la durabilité est considérée comme l’approche dominante du développement durable, celle qui a été adoptée par la plupart des institutions internationales.
- à l’inverse, l’approche de durabilité forte intègre l’état des ressources naturelles, met l’accent sur la préservation des écosystèmes et souligne la nécessité de prendre en compte l’irréversibilité environnementale. Le maintien du stock des ressources naturelles doit être recherché, partant du principe qu’il n’y a pas de substituabilité possible du capital « naturel » (point de vue de nombreuses ONG). Si la croissance n’est pas reniée, elle est cependant contrainte par des critères écologiques, et le capital naturel est considéré comme le principal facteur limitant.
Mais, le concept de durabilité doit aussi compter avec la nécessité de ne laisser personne à l’écart du développement. Cette vision solidaire, présente à l’origine dans le rapport Brundtland, insiste sur les notions d’équité et de justice intergénérationnelle. Or, la prise en compte de la dimension sociale du concept du développement durable est parfois insuffisamment considérée au regard des dimensions économique et environnementale.
- La durabilité : le résultat d’un équilibre ?
La durabilité est un terme qui recouvre un large spectre. Tout ce qui est lié à l’environnement, l’écologie, la manière de vivre de façon responsable en société et le souci de l’avenir peut être regroupé sous cette notion. Pour décrire ce terme, on fait souvent allusion à la règle des trois “P” : Personnes, Planète, Profit. Le but de la durabilité est que ces trois éléments puissent s’équilibrer.
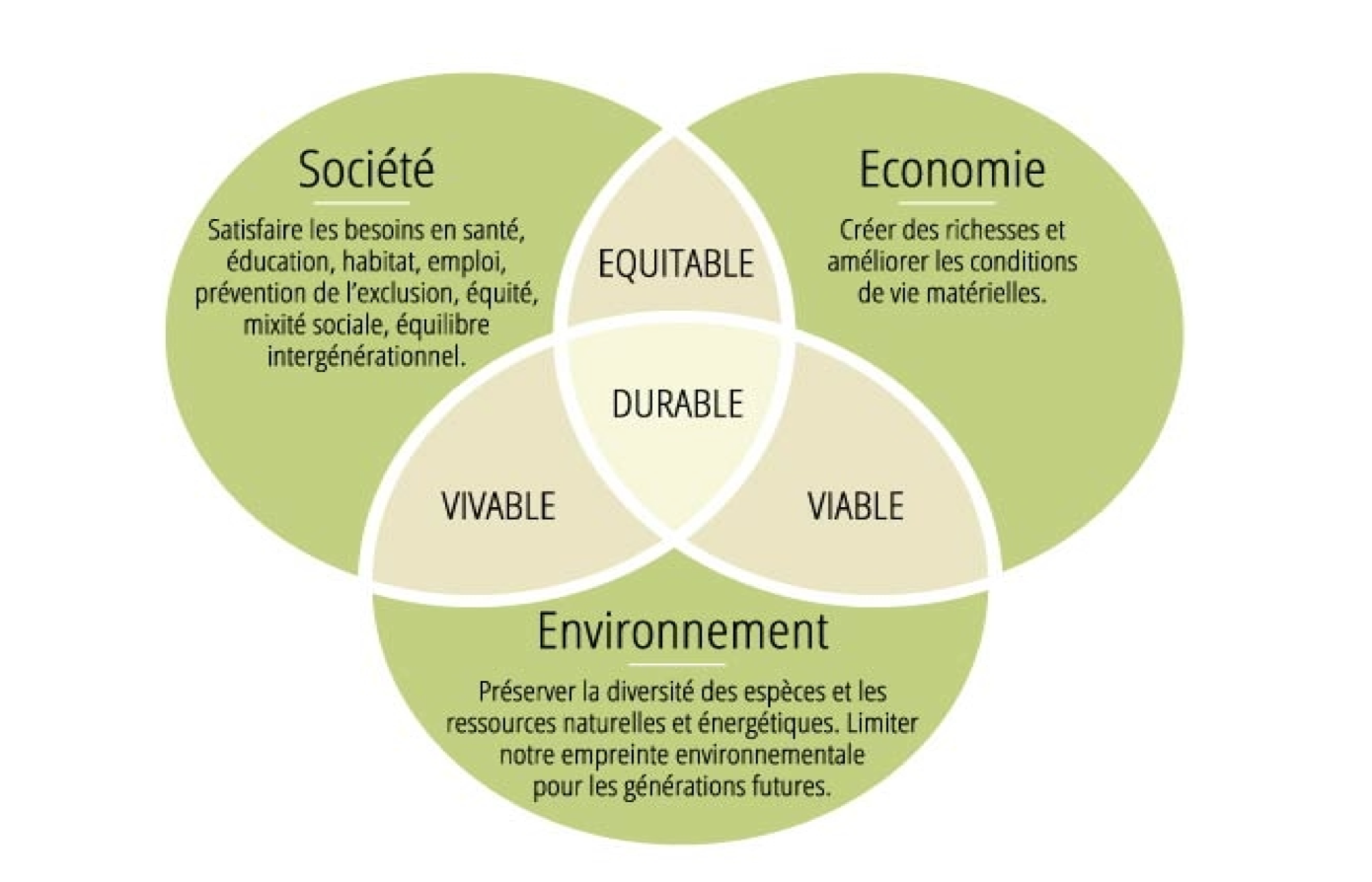
Le schéma classique des trois piliers du développement
Source : http://www.bafu.fr/la-durabilite-le-resultat-d-un-equilibre-87.html
Mais cet équilibre est difficilement atteint. Certains privilégient le pilier économique invoquant la nécessité d’une continuité de la croissance ; d’autres le pilier environnemental en soulignant l’urgence de préserver les écosystèmes fragiles ; enfin d’autres encore, revendiquant l’urgence de la lutte contre la misère, investissent le pilier social.
C’est la position d’un certain nombre d’économistes, soucieux d’introduire la notion d’éthique en économie, qui dénoncent la prévalence de la problématique environnementale au détriment de la dimension sociale et humaine (4)
1.3 La durabilité : vue par les producteurs vs les consommateurs
L’étude « Farm Perspectives Study », menée à la demande de BASF en 2014 (4) auprès de 2.100 agriculteurs et 7.000 consommateurs dans sept pays différents (Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Espagne et Etats-Unis), révèle une différence de compréhension de ce que recouvre l’agriculture durable :
• Pour les agriculteurs, la durabilité de l'agriculture prend en compte plusieurs dimensions notamment sociale et environnementale. Ainsi lorsqu'ils sont interrogés sur leur compréhension de la notion d'agriculture durable, ils évoquent des aspects d’ordre plutôt patrimonial, tels que la « protection des sols » (40 %), « l'utilisation des terres » (27 %), « l'utilisation de l'eau » (27 %) ou la « protection de la biodiversité » (25 %), mais également des aspects économiques tels que des « salaires agricoles justes » (25 %).
Pour l’agriculteur, durer est d’abord perdurer et prospérer, pour ne pas sombrer. Ses pratiques sont toutes en remaniement perpétuel sous les effets conjugués des techniques, de la finance, des réglementations et, désormais d’exigences sociétales. L’agriculteur contemporain pilote un système technique à complexité croissante dans un univers incertain. Stable et durable n’ont plus partie liée comme il en fut avant le chambardement technique, lorsque régnait « l’ordre éternel des champs ». Désormais, l’excellence puise plus à la connaissance qu’à l’expérience et à la puissance. L’excellence s’impose au paysan dans tout ce qu’il fait. « Hors l’excellence pas de salut » tient lieu de condition nécessaire à la durabilité.
• En revanche, les consommateurs conçoivent l'agriculture durable de manière plus simple. Leur vision du concept est restreinte à l'aspect environnemental qu’ils associent au « respect de l'environnement » (22 %) ou à la « capacité à produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population » (18 %).
Pour les agriculteurs, nourrir la population est une telle évidence que cet aspect n’apparaît pas dans leurs réponses, mais il est intéressant de remarquer que cette notion est manifeste chez les consommateurs.
• Néanmoins, si le respect de l’environnement reste le critère n° 1 pour les consommateurs, on remarquera que les agriculteurs sont sensibles également à la préservation de la biodiversité. Les points de vue des deux groupes divergent particulièrement quant aux pratiques agricoles. Ainsi seulement 37 % des consommateurs considèrent que la protection des cultures est menée de manière responsable tandis que 82 % des agriculteurs en sont convaincus.
Force est donc de constater que, si l’excellence de l’agriculteur est une condition nécessaire à la durabilité de son activité, ce n’est pas une condition suffisante parce que la société s’est invitée au débat. L’adage « chacun son métier et les vaches seront bien gardées » ainsi que la locution
« paysan maître chez soi » ne valent plus. Les exigences sociétales ont eu raison des frontières.
Cette montée en puissance des injonctions sociétales est causée par la curiosité et par la peur consécutive à des incidents montés en épingle par les médias. La rupture du lien direct des urbains avec « la terre » facilite cette dérive. Leurs racines ne sont plus paysannes.
La technicisation des processus de production s’ajoute à ce contexte. Elle opacifie les pratiques professionnelles rendues incompréhensibles au « commun des mortels ». Par ailleurs, engrais, pesticides, antibiotiques et tous les produits destinés à la fertilisation, à la protection des plantes et des animaux sont facilement ostracisés car, ce qui n’est pas naturel ne donne pas confiance.
Cela se traduit à chaque incident relayé par les médias. Ces derniers propagent une émotion délétère dès lors que l’événement causal est pris « brut de décoffrage », sans passage au tamis de la raison éclairée (en particulier, en relativisant mieux les notions de risque et de danger). La primauté du ressenti peut déclencher un appel excessif au principe de précaution, voire faire advenir des lois et des règlements hors de proportion.
Globalement agriculteurs et consommateurs ne reviennent pas sur la fonction première de l’agriculture qui est de nourrir la population, mais leur vision des moyens pour y parvenir diffère.
En ce qui nous concerne, nous appuierons notre réflexion sur le constat qu’en agriculture la durabilité des systèmes de production doit se placer dans la perspective d’une croissance démographique qui devrait se poursuivre au cours de ce siècle, en attendant une stabilisation naturelle.
Les projections démographiques prévoient :
- 9 milliards d’individus en 2050 (+1,7 milliards)
- 11 milliards en 2100, selon certains démographes. Des prévisions que certains qualifieront peut-être d’alarmistes… (6)
1.4 Durabilité et productivité
C’est au départ, par l’accroissement des rendements, en quantité et en qualité que l’homme parviendra à satisfaire les besoins alimentaires des populations en croissance.
Cette évolution ne peut se faire que par les acquis scientifiques et la mise en œuvre de nouvelles techniques de production, de conservation et de mise en valeur des produits récoltés. Ces nouvelles techniques devront obligatoirement permettre une meilleure prise en compte de notre environnement.
Seule l’augmentation des rendements par unité de surface cultivée permettra la préservation, dans la durée, de la plupart des biotopes planétaires non consacrés à l’agriculture. Rappelons qu’augmentation des rendements par unité de surface cultivée et préservation des biotopes naturels concourent ensemble à l’amélioration des conditions de vie des humains. Il convient de souligner que c’est surtout dans les pays en développement (PED) que les marges de progrès sont les plus élevées. Dans le contexte français, il faudra beaucoup de technicité pour maintenir la tendance.
Le rapport de l’OCDE de 2013 (7) portant sur ce sujet montre que ces deux concepts sont aujourd’hui compatibles et insiste sur le rôle de l’innovation en agriculture, seul levier permettant d’accroître la productivité tout en préservant la durabilité.
|
Durabilité et surfaces consacrées à l’agriculture : Evolution de la forêt française depuis le 19ème siècle A ce titre il est intéressant de regarder l’évolution de la forêt Française depuis 1900 : la surface en bois et forêts n’a cessé d’augmenter et a pratiquement été multipliée par trois. Ceci malgré une augmentation conséquente des surfaces non agricoles. Mais surtout grâce à une réduction sensible des surfaces consacrées à l’agriculture (prioritairement les moins fertiles), permise par l’augmentation des rendements. (8)
|
Source Agreste Mémento Statistiques agricoles – Décembre 2016
A cela il faut ajouter que toute activité durable doit répondre simultanément et de façon équilibrée aux trois objectifs suivants :
- rentabilité économique, sans laquelle aucune entreprise n’est susceptible de survivre
- protection de l’environnement
- contribution sociale au travers des conditions de travail et de l’emploi.
La poursuite de ces objectifs pose à terme la question de leur évaluation et celle des indicateurs appropriés ... (9)
|
Durabilité et économie Les réflexions sur la durabilité ne peuvent pas s’abstraire du contexte économique environnant. Caractérisé par un certain équilibre de l’offre et de la demande de produits agricoles et agro-alimentaires, ce contexte économique n’échappe pas à l’évolution de la demande des consommateurs et des citoyens. A titre d’exemple, observons actuellement la très forte demande en agrobiologie comme la baisse bien engagée de la consommation de produits carnés. Le contexte économique de l’évolution de l’agriculture est fortement orienté et impacté par la PAC et ses exigences ; la PAC actuelle, très critiquée aujourd’hui pour avoir abandonné la gestion des marchés, évoluera probablement à partir de 2021, les discussions sont en cours. Cette nouvelle PAC risque de se définir dans un contexte budgétaire tendu du fait du Brexit et aussi des besoins budgétaires d’autres chantiers européens à venir. Elle sera sans aucun doute influencée par les nouvelles demandes de la Société qui souhaitera conditionner les aides aux agriculteurs par plus d’agro-écologie. Les aides directes de la PAC actuelle pourraient être diminuées par des transferts budgétaires opérés vers des actions de régulation des marchés ; elles pourraient aussi être repensées le cas échéant en reconsidérant le type d’agriculture souhaitée. La future PAC sera également marquée et orientée par l’évolution de l’OMC et des traités bilatéraux éventuels.
|
Références bibliographiques
(1) Jégou Anne, « Les géographes français face au développement durable », L'Information géographique, 2007/3 (Vol. 71), p. 6-18. DOI : 10.3917/lig.713.0006. URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-3-page-6.htm
(2) Meadows, Donella H. and Dennis L., Randers Jørgen, Behrens William W. III, The Limits to Growth, Universe Books, New York (1972a). Traduction française complétée : Halte à la croissance ? Fayard, Paris (1972b).
https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/
(3) https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
(4) Ballet Jérôme, Dubois Jean-Luc, Mahieu François-Régis, « La soutenabilité sociale du développement durable : de l'omission à l'émergence », Mondes en développement, 2011/4 (n°156), p. 89-110. DOI : 10.3917/med.156.0089. URL : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-4-page-89.htm
(5) http://presse.basf-agro.fr/galerie/documents/institutionnel/2014/communique-grpe-basf-etude-vision-agriculture(1).pdf - communiqué de presse sur les résultats de l’étude
http://presse.basf-agro.fr/galerie/documents/institutionnel/2014/farm-perspectives-study%2C-2014-main-findings.pdf – lien vers les résultats de l’étude (en anglais)
(6)
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?tx_ttnews[tt_news]=2525
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
(7) Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, Productivité et durabilité en agriculture sont-elles compatibles ?, présentation du 30 mai 2013
http://www.phytofar.be/Files/Upload/Docs/Leterme_productivit%C3%A9_%20mai%202013_bis.pdf
(8)L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux droits à paiement unique -
Maurice Desriers / L’agriculture, nouveaux défis - édition 2007
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf
Abandon et artifi cialisation des terres agricoles1 Philippe Pointereau, Frédéric Coulon Solagro, 75 voie du TOEC, 31076 Toulouse cedex 3 Courrier de l’environnement de l’INRA n° 57, juillet 2009
https://www7.inra.fr/dpenv/pdf/PointereauC57.pdf
(9) Vivien Franck-Dominique, Lepart Jacques, Marty Pascal, L’évaluation de la durabilité. Editions Quæ, « Indisciplines », 2013, 272 pages. ISBN : 9782759219049. DOI : 10.3917/quae.vivie.2013.01.
URL :
https://www.cairn.info/l-evaluation-de-la-durabilite--9782759219049.htm
2. ENERGIE ET DURABILITE DE L’AGRICULTURE
|
Résumé L’énergie est une composante forte de la compétitivité et de la durabilité de l’agriculture française. 80% des besoins énergétiques du secteur sont satisfaits par des énergies fossiles. Par ailleurs 18% des émissions nationales en équivalent CO2 de gaz à effet de serre sont dues au secteur agricole. Les prix des matières premières issues des énergies fossiles devraient rester très volatils et très spéculatifs et liés beaucoup plus au contexte géopolitique qu’à la quantité des réserves disponibles qui, elles-mêmes, évoluent du fait de nouvelles technologies d’extraction. Le secteur agricole dispose de ressources qui le dotent d’un fort potentiel d’énergies renouvelables non intermittentes, pour l’instant peu exploitées en France (biocarburants, biomasse, méthanisation). Ces énergies peuvent être valorisées en carburants et combustibles. Le secteur agricole peut ainsi contribuer à la transition énergétique, question majeure en raison de la nécessité de maîtriser les gaz à effet de serre et de réduire la dépendance de la France des énergies fossiles. La réduction de la consommation d’énergie des exploitations est un enjeu économique important. Les exploitants doivent être incités à effectuer des diagnostics énergétiques et à réaliser des investissements pour réduire leurs consommations d’énergie. La maîtrise des gaz à effets de serre (méthane, protoxyde d’azote et CO2) reste un point crucial. Si la part de l’agriculture ne représente que 18% des émissions derrière le transport, le logement et l’industrie, sa contribution est néanmoins non négligeable du fait du méthane et du protoxyde d’azote. Cette maitrise des gaz à effet de serre passe par des stratégies d’atténuation : simplification du travail du sol, raisonnement des apports d’azote, valorisation de l’azote par des légumineuses, production d’énergie. Elle passe également par des stratégies de séquestration de carbone dans le sol : augmentation des restitutions au sol sous forme de biomasse végétale, couvertures végétales d’intercultures ou semis sous couvert. Il est également nécessaire d’introduire des stratégies d’adaptation qui ne doivent pas s’opposer aux stratégies d’atténuation mais les compléter : adaptation des variétés aux évolutions du climat, meilleure gestion territoriale de l’eau d’irrigation, suivi des bioagresseurs permettant d’anticiper les évolutions parasitaires. Alors que la plus grande partie de l’attention est portée sur la nécessaire réduction des émissions, il paraît important de faire valoir tous les travaux menés pour renforcer l’effet puits de carbone des productions végétales et les stratégies d’adaptation
|
L’énergie est une composante forte de la compétitivité et la durabilité de l ‘agriculture Française. Elle est au cœur d’un nouveau modèle agricole productif et écologiquement responsable.
L’agriculture est consommatrice d’énergies fossiles et structurellement dépendante des sources extérieures d’approvisionnement. Par ailleurs, le secteur agricole dispose de ressources (foncier, biomasse) qui le dotent d’un fort potentiel d’énergies renouvelables.
Mais la question énergétique concerne également la localisation des activités agricoles à travers les transports nationaux et internationaux des produits agricoles et des intrants. Des leviers d’amélioration (technologies économes, modification des systèmes de production, réorganisation des filières) sont à l’étude, voire disponibles.
La capacité d’adaptation de l’agriculture Française à ces défis sera déterminante pour l’avenir du secteur et de sa compétitivité.
2.1 Des énergies plus rares et plus chères ?
2,8% de la consommation totale d’énergie finale française en 2012 est absorbée par l’agriculture, 80% des besoins énergétiques du secteur sont satisfaits par les énergies fossiles et 17,8% des émissions nationales en équivalent CO2 de gaz à effet de serre en France sont imputées au secteur agricole (émissions de protoxydes d’azote et de méthane). Dans le même temps elle produit de l’énergie sous forme de biocarburants et de biogaz (méthanisation).
A elles seules, les dépenses d’énergies directes représentent en moyenne 8,7% des charges variables sur une exploitation.
La volatilité des cours de l’énergie fossile complexifie l’analyse de l’impact des prix de l’énergie sur les revenus agricoles.
Les hypothèses d’énergies fossiles plus chères sont les plus fréquentes, mais ces hypothèses sont-elles réalistes ?
Au plan mondial, des études de la société EXXON sur les énergies fossiles montrent que le pétrole et le gaz resteront encore les énergies dominantes à l’horizon 2040. Le gaz naturel devrait représenter un quart de la demande d’énergie.
Les pétroliers misent notamment sur les gaz de schistes, dont les ressources disponibles seraient importantes. Leurs études indiquent qu’avec des nouvelles technologies d’extraction, les USA disposeraient de 160 années de réserves !! Des projets encore plus futuristes tablent également sur la libération de gaz naturel à partir des gisements d’hydrates de méthane, mais au prix d’impacts environnementaux importants.
Le prix de ces matières premières devrait rester très volatils et très spéculatifs. Ainsi en 2013-2015, l’OPEP et la Russie ont réussi, par une production soutenue, à faire baisser les prix du baril de pétrole à 30 dollars. La production de gaz de schistes américain a été fortement ralentie et a conduit à la fermeture de nombreux puits aux USA. Mais, c’était une situation antiéconomique, difficile à tenir pour les pays de l’OPEP. En 2016, le prix du baril est remonté à 40-50 dollars. En moins de 6 mois, les sociétés américaines ont remis en place les forages de gaz de schistes. En effet, ces derniers sont moins coûteux et plus rapides à remettre en route par rapport à des forages traditionnels. D’autre part, un très gros progrès a été réalisé dans les techniques d’extraction : le seuil de rentabilité serait tombé à 25 dollars le baril dans certains comtés du Texas.
2.2 Energies renouvelables, un atout ?
La question de la transition énergétique est une question majeure en raison de la nécessité de maitriser les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des combustibles fossiles. Dans l’état actuel du débat les français sont conduits à penser qu’il serait possible de développer massivement les énergies renouvelables, et notamment l’éolien et le solaire comme moyen de décarbonation du système en le débarrassant à la fois des énergies fossiles et du nucléaire .
L’Académie des sciences a dressé, dans une communication le 19 avril 2017, un état critique sur la question de cette transition énergétique.
Le recours aux énergies renouvelables est à priori attrayant mais il ne faut pas oublier les réalités. L’électricité ne représente que 25% de la consommation d’énergie française et il faut bien distinguer le mix énergétique qui concerne l’ensemble de nos activités du mix électrique. Pour les éoliennes, le facteur de charge moyen en France (rapport entre l’énergie produite et celle qui correspond à la puissance maximale affichée) est de 23% ; il est de 13% pour le solaire photovoltaÏque. Les chiffres de production éolienne en France montrent que la puissance disponible issue de l’ensemble des éoliennes réparties sur le territoire tombe souvent à 5% de la puissance affichée. Cette variabilité des énergies renouvelables éoliennes et surtout solaires nécessite la mise en œuvre d’énergies alternatives pour pallier cette intermittence et compenser la chute de production résultant de l’absence de vent ou de soleil.
Cette solution à l’intermittence pourrait être le stockage massif de l’électricité dans les périodes excédentaires pour la rendre disponible aux moments où elle est nécessaire. Le stockage pourrait être réalisé dans les installations hydroélectriques. Mais leurs capacités de stockage sont presque saturées. Les autres modes de stockage (technologie lithium-ion, électrolyse de l’eau qui produit de l’hydrogène) sont pour l’instant trop chères, leur rendement est faible et leur maturité technologique réduite.
A titre d’exemple, en Allemagne, depuis 2011, c’est la croissance de l’offre intermittente d’électricité produite par les renouvelables qui a nécessité l’ouverture de nouvelles capacités de production thermique à charbon et un développement de l’exploitation du lignite.
L’Académie des sciences indique que le tout renouvelable ne sera pas possible et que la trajectoire raisonnable sera une solution où l’énergie nucléaire aura sa place si l’on veut maintenir une électricité décarbonée. Elle trouve donc qu’il serait plus judicieux de porter les efforts sur les questions des économies d’énergie qui peuvent être réalisées pour réduire les consommations dans le bâtiment, le transport, les industries.
2.3 Energies agricoles renouvelables mais non intermittentes
Parallèlement à leurs activités traditionnelles, les exploitations agricoles développent des activités de production d’énergie, soit pour une autoconsommation, soit pour les revendre sur les réseaux énergétiques.
Outre les unités de production électriques intégrées aux installations agricoles (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.), deux principales voies de valorisation de la biomasse s’ouvrent aux exploitants agricoles : les biocarburants et la méthanisation. Ces deux dernières voies font partie des énergies renouvelables mais qui, si elles sont bien techniquement orientées, ne sont pas des énergies intermittentes car productrices de carburants ou de gaz qui peuvent être stockés.
2.3.1 Biocarburants
Les biocarburants actuellement produits sont principalement créés à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles issus de la biomasse (dits de 1ère génération par convention), par exemple des matières végétales produites par l’agriculture et pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale (betterave, blé, maïs, colza, tournesol, pomme de terre, etc.).
Le bioéthanol est actuellement produit à partir de canne à sucre, de céréales (blé, maïs) ou de betterave sucrière. Il est utilisé dans les moteurs à essence.
Le biodiesel est dérivé de différentes sources d’acides gras, notamment les huiles de soja, de colza, de palme et d’autres huiles végétales. Il est utilisé dans les moteurs diesel.
La France était le deuxième producteur européen de biocarburants derrière l’Allemagne, avec 1,8 Mtep produits en 2012, soit environ 10,7% de la production française d’énergie renouvelable (énergie primaire) Le taux d’incorporation des biocarburants dans l’essence et le diesel est amené à augmenter. Il constituait 6,8% de la consommation totale de carburant en France en 2012.
Les biocarburants de 1ère génération entrent partiellement en concurrence avec la production alimentaire mais les effets de cette concurrence restent difficiles à mesurer. Par ailleurs, la production de biocarburants de première génération génère des co-produits souvent valorisés en alimentation animale (ex : tourteaux de colza). Ils laissent au sol assez de résidus pour conserver sa fertilité.
Des biocarburants dits de 2e génération, à l’état de recherche et de pilote visent en revanche à exploiter les matières cellulosiques telles que le bois, les feuilles et les tiges des plantes ou celles issues de déchets agricoles. Ils pourraient prendre le relais des carburants de première génération à partir de 2025.
Les matières cellulosiques ne sont pas comestibles par l'Homme et les biocarburants de 2e génération n'entrent pas en concurrence directe avec l'alimentation, mais ils occupent néanmoins des surfaces qui pourraient être destinées à la production alimentaire. L’inconvénient majeur est que, pour cette production réalisée à partir de plantes entières, on devra restituer au sol les éléments (matière organique) qui lui auront été pris.
La commission Européenne a présenté un projet de révision de la directive relative aux énergies renouvelables pour la période post-2020. L’exécutif propose de limiter la part des biocarburants de 1° génération dans les transports d’un maximum de 7% en 2021 à 3,8% en 2030.
L’industrie de l’éthanol estime que l’abaissement du plafond des biocarburants traditionnels à 3,8% était en contradiction avec l’investissement de 16 milliards d’euros dans les infrastructures européennes consenti depuis 2003 dans le cadre de la stratégie existante qui expire en 2020. Cette nouvelle politique pourrait coûter 133 000 emplois en Europe. Certains estiment même que cette limite encouragera l’utilisation de carburants fossiles dans les transports faute de disposer après 2020 des capacités suffisantes en biocarburants de 2° génération.
2.3.2 Méthanisation
La méthanisation est un processus de décomposition de végétaux ou de matières pourrissables (ex : lisiers d’élevage, effluents agro-alimentaires, déchets agricoles solides, etc.) par des bactéries qui agissent en l’absence d’oxygène.
Elle permet de produire :
- du biogaz qui comporte entre autres du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2). Le biogaz peut être transformé en chaleur, en électricité et en carburant pour véhicules ;
- du compost, un « digestat » utilisé comme fertilisant.
- La production énergétique d’une unité de méthanisation traitant 15 000 tonnes/an de déchets permet, en équivalence :
- d’assurer la consommation de carburant de 60 bus urbains par an ;
- de garantir le chauffage de 700 maisons ou l’eau chaude sanitaire de 3 500 maisons par an .
L’injection du Biogaz dans le réseau et la valorisation du biogaz en carburant est une piste encore peu développée en France. C’est pourtant la plus rentable. C’est notamment le choix qu’ont fait certains pays européens (Suède, Suisse).
La production française de biogaz a atteint 443 000 tep en 2012, soit approximativement 2% de la production française d’énergie renouvelable (énergie primaire).
En 2013, 158 unités de méthanisation étaient répertoriées en France. Le projet de loi de programmation de la transition énergétique présenté en juin 2014 prévoyait la mise en place de 1 500 méthaniseurs en milieu rural en 3 ans.
Malheureusement, en 2015, la méthanisation agricole en France ne semblait pas tenir ses promesses. La France a voulu s’inspirer de l’Allemagne qui a mis sur pied une véritable filière d’énergies vertes à la ferme en douze ans. Les agriculteurs-méthaniseurs sont au nombre de 8000 outre-Rhin. La clef de la réussite germanique a été d’une simplicité qu’on n’a pas voulu répliquer en France. Les agriculteurs allemands ont pu utiliser des cultures dédiées (maïs, betteraves) à cette fonction, pour compléter les effluents d’élevage dans la ration des unités de méthanisation. En France, on ne peut utiliser que des effluents d’élevage, donc une rentabilité réduite.
Malgré toutes ces contraintes, l’association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, forte de 200 agriculteurs exploitant des unités de méthanisation individuelles ou collectives, en liaison avec toute la profession agricole s’est mobilisée. Elle a pu obtenir en 2017, au bout de 4 années de négociation avec le Ministère de l’agriculture, un nouveau dispositif réglementaire et tarifaire. Dans ce dispositif, il est notamment prévu que les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et les prairies naturelles peuvent être utilisées sans restriction et que la part des cultures dédiées pourrait être au maximum de 15%.
2.4 Réduire la consommation d’énergie des exploitations
La maîtrise des consommations énergétiques constitue un enjeu économique de plus en plus sensible pour les exploitations agricoles. Avec la hausse du prix des produits pétroliers, celles-ci doivent en particulier repenser leur logistique, la distance entre lieux de production et de consommation ou encore leur approvisionnement en intrants. Les charges liées à l’énergie sont plus ou moins lourdes en fonction des activités. Elles peuvent atteindre jusqu’à 30% à 40% des charges d’exploitation dans le cas de cultures sous serres chauffées (le prix du gaz constitue alors un indicateur majeur de la santé économique de ces sites).
Dans le cadre du plan performance énergétique (PPE) du ministère de l’agriculture lancé en 2009, les exploitants sont incités, avec l’aide de subventions, à :
- réaliser des investissements pour réduire leur consommation d’énergie (ex : équipements de récupération de chaleur, matériaux d’isolation pour les bâtiments d’élevage, etc.) ;
- produire de l’énergie renouvelable (ex : unités de méthanisation, séchage des fourrages avec des énergies renouvelables, etc.).
En amont, les exploitants sont également incités à réaliser des diagnostics énergétiques pour identifier les moyens de réduire leurs dépenses d’énergie sans réduire leurs niveaux de production.
Un plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (5) s’applique désormais à la période 2014-2020.
2.5 Maitriser les gaz à effet de serre
Il convient tout d’abord de relativiser la contribution française à l’émission de GES. Elle représente 1.2% des émissions globales quand la Chine et les USA représentent environ 40%. A titre de comparaison la seule croissance annuelle chinoise représente 1 à 2 fois la production annuelle française. Avec environ 6t/an d’équivalent CO2 émis par habitant, la France se situe dans la moyenne mondiale et en dessous de la moyenne européenne. La part de l’agriculture française représente 19% des émissions, derrière les transports, le logement et l’industrie. Elles ont d’ores et déjà baissé de 12% sur la période 1990-2010. La contribution agricole est composée de méthane (45%), de protoxyde d’azote (45%) et de CO2 (10%) provenant essentiellement de la consommation de carburant.
Concernant ce dernier point, on voit tout de suite que les économies de consommation de carburant, même si elles ne doivent pas être négligées, représentent un enjeu faible.
Le méthane est issu principalement de la fermentation entérique des ruminants. C’est un phénomène naturel d’origine bactérienne qui ne peut être atténué mais difficilement que par l’alimentation des animaux. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’herbe a préalablement fixé du CO2 en bien plus grande quantité que la fraction consommée par les animaux. Le bilan reste positif avec la prairie qui est un puits de carbone, en particulier sous forme de matière organique dans le sol.
D’autres sources d’émission, moins importantes, existent néanmoins : rizières, décharges, stockage d’effluents, etc…
Le protoxyde d’azote (N2O) est principalement attribué aux surfaces de terres cultivées. Il faut cependant savoir qu’en l’absence de protocole d’observation fiable, le GIEC rattache par convention les émissions de N20 proportionnellement aux quantités d’engrais azotés utilisées, à raison de 1%. Ce détail a toute son importance par la suite car pris dans son expression finale il pourrait conduire à déduire que la seule façon de réduire le N2O est de diminuer l’utilisation des engrais azotés. Ce qui est évidemment plus complexe sur le plan agronomique, d’autant que c’est un sous-produit qui se forme aussi bien à partir des composés minéraux que organiques. Toutes les cultures sont donc concernées et on ne peut pas espérer l’éliminer mais seulement minimiser sa production.
2.5.1 Stratégies d’atténuation
Tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture, sont mis à contribution pour indiquer les voies possibles de réduction des émissions de GES. Dans ce cadre il parait utile de mettre en avant les travaux d’évaluation qui ont été conduits sur :
- La simplification du travail du sol qui peut conduire à une économie de 40% de carburant (Labreuche et al) mais ce poste ne représente que 10% des émissions agricoles.
- Les travaux conduits au champ pour étudier les émissions de protoxyde d’azote (Cohan et al). Il ressort de ces premiers travaux le caractère multifactoriel de l’émission de N2O sans qu’il soit possible d’attribuer spécifiquement l’émission de N2O à une pratique culturale bien précise. On peut cependant avancer que tout ce qui conduit à mieux raisonner les apports d’azote (dose d’azote, pilotage…), limitant les excès d’azote minéral dans le sol, contribue à diminuer les émissions de N2O.
- Les fertilisants azotés de synthèse nécessitent pour leur fabrication l’utilisation d’énergie fossile (gaz naturel, pétrole…). Toute économie de fertilisant azoté limite également l’utilisation de carbone fossile. La valorisation de l’azote fixé par les légumineuses ainsi que celui contenu dans les produits résiduaires organiques (PRO) contribue à limiter indirectement l’émission de carbone pour la fabrication des engrais.
- La production d’énergie à partir de la biomasse agricole ou forestière, soit par combustion directe soit par la voie des biocarburants en substitution à l’utilisation d’énergie fossile, est une voie d’atténuation non négligeable.
2.5.2 Stratégie de séquestration
Cette voie peut être assimilée à la voie de l’atténuation parce qu’elle contribue à stocker durablement le carbone. Les sols français représentent un réservoir de carbone de 3 à 4 milliards de tonnes de carbone (Mousset et al). Certains estiment que le stockage additionnel de carbone dans les sols pourrait atteindre 1 à 3 millions de tonnes par an pendant 20 ans, ce qui compenserait 3 à 4% des émissions françaises de GES.
La culture du blé fixe 4 fois plus de carbone dans l’air qu’elle n’en consomme directement ou indirectement pour sa production mais le protocole du GIEC ne retient comme carbone durablement fixé que la partie supplémentaire stockée dans les matières organiques du sol. Le stockage de carbone dans les sols ne peut se concevoir que par une augmentation des restitutions au sol sous forme de biomasse végétale. Plusieurs travaux présentés au colloque « faut-il travailler le sol ? » (avril 2014) permettent de faire le point sur les facteurs influant le stockage de carbone. On y apprend que l’augmentation globale de la production de biomasse (augmentation des rendements en grains et résidus de culture) est le premier facteur de croissance du taux de matières organiques. Les couvertures végétales d’interculture ou en semis sous couvert, vont dans le même sens. En revanche, contrairement à une idée reçue, la simplification du travail du sol et le semis direct n’ont pas d’effet sensible sur le stock de matières organiques (Mary et al, 2015)
2.5.3 Stratégie d’adaptation
Parallèlement aux efforts nécessaires de réduction des émissions, il est nécessaire d’instruire des scénarii d’adaptation. Les stratégies d’Atténuation (école européenne) et les stratégies d’Adaptation (école américaine) ne doivent pas s’opposer mais au contraire se compléter mutuellement.
En termes de voies de progrès, il convient de signaler plusieurs actions conduites au sein des instituts de recherches, concourant à mettre en place des stratégies d’adaptation :
- Le programme de phénotypage haut débit visant à identifier des résistances génétiques à la sécheresse est une initiative totalement orientée vers l’objectif d’obtenir dans un futur proche des variétés mieux adaptées aux tendances d’évolution du climat (« comment prévoir l’imprévisible », Science et Vie Juillet 2015) https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_35436/fr/epandage-des-boues?cid=vmr_35728&portal=cbl_7386
- Les stratégies de gestion territoriale de l’eau d’irrigation, développées au travers de l’UMT EauT, contribuent également à augmenter l’efficience de l’irrigation. On peut y ajouter aussi le développement des outils d’aide à la décision pour le pilotage de l’irrigation (Irré-LIS). Le déséquilibre temporel entre les précipitations (hivernales) et les besoins supplémentaires (estivaux) exprimés par les cultures devrait conduire, comme cela est le cas dans d’autres pays, à renforcer la stratégie de création de réserves d’eau (d’irrigation et de consommation). Cela d’autant plus que le territoire français bénéficie en Europe de la deuxième ressource d’eau renouvelable après la Norvège et n’exerce actuellement qu’un faible taux d’utilisation de ses ressources.
- Le suivi des bioagresseurs (BSV et autres réseaux), la modélisation de leur épidémiologie (MILEOS, Septo-LIS…) permettent d’anticiper les évolutions parasitaires. On a vu par exemple l’évolution territoriale des foreurs sur maïs, du taupin dans les régions françaises, de la rouille jaune au cours des deux dernières années…etc. Il n’est pas certain que l’évolution de ces bioagresseurs soit directement imputable aux évolutions climatiques, l’évolution des moyens de lutte peut aussi en porter une part de responsabilité. Cependant il reste important de pouvoir suivre ces évolutions afin de les anticiper et d’adapter les moyens de lutte en conséquence. C’est bien une stratégie d’adaptation.
2.6 Conclusions :
Les instituts, par leurs travaux sur l’émission de GES en agriculture, contribuent à éclairer un sujet de portée sociétale. Il paraît important, comme le confère leurs missions d’apporter dans les débats ces éclairages, étayés par l’expérimentation, qui doivent rester objectifs. Alors que la plus grande partie de l’attention est portée sur la nécessaire réduction des émissions, il parait aussi important de faire valoir tous les travaux qui sont menés pour renforcer l’effet puits de carbone des productions végétales et les stratégies d’adaptation notamment par la contribution à la création de variétés plus tolérantes au stress hydrique.
BIBLIOGRAPHIE :
Energies fossiles :
- Exxon’s 2040 outlook : fossils fuels aren’t going anywhere – 31 /12/2016
www.Thegwpf.com/exxons-2040-outlook-fossils-fuels. - More over fracking : a new energy revolution in the making- 06/12/2016 -James Watkins,OZY NEWS
- Hail shale : OPEC is losing the global oil game – Jesse Snyder –10/03/ 2017- GWPF newsletter 14/03/17.
- Methane hydrate fuel, a new energy regime . Global Warming Policy Forum, 16 May 2012.
- China claims : Méthane Hydrates breakthrough may lead to global energy revolution CNN Money, 20 May 2017
- Aux Etats Unis, l’investissement repart dans le pétrole de schistes – Jean Claude Bourbon 01/01/2017
www.la-croix.com/économie - Comme prévu, la production américaine d’huile de schistes repart à la hausse et pèse sur les cours ; Jean Claude Bourbon,14/03/2017.
www.la-croix.com/economie
Energies renouvelables et transition énergétique
- Au diable les énergies renouvelables. Michel Gay, groupe CCEE-mars 2017.
- Cette si coûteuse transition énergétique – Xavier Pinon- La tribune 08/02/2016.
- La question de la transition énergétique est-elle bien posée dans les débats actuels ? Institut de France, Académie des sciences, 10 Avril 2017.
- Institut Montaigne : Energie, priorité au climat –Benjamin Frémaux –note de juin 2017.
- Energies agricoles et réduction de la consommation d’énergie
- Les végétaux, un nouveau pétrole ? Jean François Morot Gaudry –Editions QUAE 21 mars 2016
- Energie et Agriculture en France - 20/06/2017
www.connaissancedes energies.org/fiche-pédagogique/énergie - Agriculture Energie 2030 : comment l’agriculture s’adaptera-t-elle aux futurs défis énergétiques ? Centre d’études et de prospectives N°17 Avril 2010 – Ministère de l’Agriculture.
- Etat des lieux et perspectives des biocarburants 2016- IFP Energies nouvelles.
www.ifpenergiesnouvelles.fr - La commission met un coup d’arrêt aux biocarburants. 01/07/2017
www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation. - Face à la menace qui pèse sur les biocarburants, la FNSEA et le SER lancent un cri d’alarme. Communiqué de presse du 02/07/2017.
www.fnsea.fr/presse-et-publications/espace-presse. - La méthanisation agricole ne tient pas ses promesses. Marie José Cougard 03/03/2015 les echos.fr/03/03/2015 /les Echos
- Quel modèle agricole derrière le plan méthanisation ? Sophie Fabrégat 09/03/2015
www.actu-environnement.com - Un avenir enfin plus serein pour la méthanisation agricole Française. Frédéric Douart 01/03/2017
www.bioenergie-promotion.fr/49894 - Les cultures intermédiaires à vocation énergétiques : un itinéraire bien spécifique. A. Besnard, S. Marsac (Arvalis Institut du végétal)
www.arvalis-info.fr/view-19062
Maitriser les gaz à effet de serre
- Durabilité des pratiques agricoles : Etat des lieux et Evolutions. Arvalis Institut du végétal – juin 2015.
- Atténuation de l’émission de GES et adaptation au changement climatique. JP. Bordes - septembre 2015 document interne – Arvalis Institut du végétal
3. LE SOL : UN ELEMENT PATRIMONIAL CLE DE LA DURABILITE
|
Résumé Le sol est le support de tous les végétaux cultivés. Il doit être préservé pour assurer une production agricole en quantité et de qualité. Les rythmes d’évolution de la fertilité peuvent être très lents quand il s’agit de la formation des sols et peuvent être rapidement bousculés par les pratiques culturales. Il en a toujours été ainsi. Les équilibres sont sans cesse en évolution avec la mise au point de nouvelles techniques. Le risque le plus important pour les sols agricoles réside d’abord dans son artificialisation (accroissement constant des zones péri-urbaines, industrielles ou voies de communication) qui empiète sur la surface réservée à l’agriculture. En second lieu, l’érosion peut dégrader certains sols plus fragiles. Mais il ne faut pas assimiler la situation de la France avec celle des grandes zones fragilisées au niveau mondial (surexploitation forestière par exemple). En effet, des pratiques culturales adaptées permettent aujourd’hui, même en zones de grandes cultures, d’éviter ce risque d’érosion. Les pollutions des sols concernent surtout des situations particulières comme les friches industrielles et relèvent d’abord de problèmes d’artificialisation, plutôt que d’agriculture. D’ailleurs, les sols de grandes cultures ne sont pas le milieu stérile évoqué parfois par certains commentateurs peu avertis. Ils sont au contraire d’une grande richesse et recèlent une biodiversité insoupçonnée, différente de celle d’autrefois, car entretenue indirectement par les agriculteurs. Enfin, au cours du XXème siècle, on peut affirmer que la fertilité des sols s’est largement accrue au niveau du territoire national. En effet, les teneurs en éléments nutritifs ont été augmentées en même temps que les rendements des cultures. Dans un futur proche des innovations technologiques comme l'agriculture de précision, les robots de désherbage, permettront de réduire plus encore le recours aux herbicides qui représentent les principaux produits pouvant interagir avec l'activité biologique des sols. C’est aussi au travers de l’aménagement du territoire et une meilleure prise en compte des abords des parcelles cultivées que des solutions sont à élaborer. Elles concernent en particulier la biodiversité fonctionnelle, celle qui maintient les équilibres entre les parasites des cultures, leurs ennemis naturels ainsi que la faune et la flore non agricole.
|
| 3.1 Préambule et définition :
Pour caractériser la « durabilité » d’un sol plusieurs dimensions peuvent être invoquées, comme sa profondeur, sa
Enfin, des critères de bilan carbone, d’énergie consommée pour le travail du sol, de temps de travail et donc de rentabilité du matériel et de la main d’œuvre sont autant de domaines qui sont influencés par d’éventuelles modifications du sol. |
Mais en se concentrant sur le domaine de la production agricole, il devrait être possible d’affirmer que maintenir la durabilité du sol consiste à obtenir un niveau de production des cultures élevé et de qualité, voire de l’améliorer à condition de ne pas entamer la possibilité de revenir au moins à la situation de départ (pas de pollution irréversible, ni d’érosion par exemple).
C’est ce que font la grande majorité des agriculteurs : maintenir ou améliorer leur niveau de production – (sans ignorer les excès qui ont pu se produire lors d’une mécanisation mal contrôlée ou qui peuvent encore avoir cours actuellement dans certaines régions du monde : déforestation, brulis, salinité induite par l’irrigation, etc.)
Or, une opinion semble se répandre dans le public non-agricole et tend à faire croire que les pratiques dites « conventionnelles » conduisent inexorablement à une baisse de la fertilité des sols en provoquant leur « quasi-stérilisation ». Il n’y aurait alors pas de salut pour l’agriculture de nos régions sans une modification profonde des pratiques et plus particulièrement celles qui concernent le travail du sol. Il ne s’agit pas nécessairement, dans ces approches, du concept d’agriculture « bio », mais plutôt de techniques en cours d’évaluation telles que « l’agriculture de conservation » ou plus extrêmes comme la « permaculture » (couverture permanente du sol : voir l’expérience en cours sur la ferme du Bec Hellouin). Cette dernière démarche, dont les résultats ne sont pas réellement probants, confond à la fois des aspects techniques (mesurables) et une dimension idéologique qui promeut plutôt un modèle de vie ou de société, que nous ne jugeons pas, car hors de notre propos.
3.2 Le premier constat pourrait être le suivant : « en agriculture, la durabilité des techniques culturales n’a jamais existé, il a toujours fallu corriger les pratiques ! »
L’introduction de nouvelles pratiques culturales, visant l’amélioration des rendements, modifie les équilibres au niveau du sol et du système de culture et s’avère généralement « non durable » à plus ou moins longue échéance.
En effet, la mise en culture des premiers végétaux a profondément modifié les équilibres naturels qui évoluaient au rythme des dernières glaciations (à l’échelle de dizaines de milliers d’années). La déforestation générée par des incendies provoqués volontairement a été un des premiers moyens utilisé par l’Homme pour maîtriser le milieu. Mais la durabilité du système sur brûlis était mauvaise, puisqu’il fallait régulièrement changer de situation pour bénéficier d’une fertilité nouvelle en conquérant toujours de nouveaux territoires.
Pendant longtemps, les rendements sont restés extrêmement bas, sauf sur des surfaces très localisées où étaient concentrés les cendres des foyers et les apports organiques liés aux populations et aux animaux d’élevage. Après quelques années de culture sur des terres nouvellement défrichées, les rendements baissaient et il fallait laisser « reposer le sol » avec une interruption, c’était la pratique de la jachère. L’avènement de la fumure minérale a permis un réel gain de productivité qui a fait émerger de nouveaux facteurs limitants qu’il fallait à leur tour lever si l’on voulait continuer à progresser. Les maladies, les insectes ravageurs ont toujours existé, mais ils devenaient alors la nouvelle difficulté qu’il fallait surmonter… Chaque fois qu’un pas est fait, de nouveaux obstacles (préexistants) surgissent et demandent de nouvelles mises au point.
3.3 Les sols agricoles se sont formés il y a très longtemps et sont toujours en évolution.
Les sols ont des origines très différentes, ils proviennent de la lente évolution (physico-chimique) pendant plusieurs millénaires des roches-mères (avec des apports extérieurs éventuels comme les alluvions glacières, fluviales, lacustres, ou des dépôts éoliens : limons des plateaux) sous l’action du climat et de la végétation qu’ils portent. L’horizon de surface (la terre arable) est progressivement enrichi par la dégradation de la matière organique vivante (végétaux, animaux, microorganismes) et s’enrichit plus ou moins en humus stable (dont la minéralisation contribue pour partie à l’alimentation des végétaux cultivés). Ces processus sont permanents et se poursuivent toujours car ils tendent très lentement vers un équilibre. Mais ces lentes modifications peuvent être totalement masquées par des bouleversements beaucoup plus rapides liées à l’activité humaine. L’agriculture contribue à façonner des sols adaptés aux cultures pratiquées. En France, la plupart des forêts portées par des sols fertiles ont été déboisées (abbayes au Moyen Age), de nombreuses zones humides sont drainées parfois depuis très longtemps, des surfaces ont été gagnées sur la mer (zones de polders – derrière des digues : réseaux de canaux et d’écluses), etc… Ces travaux d’aménagement ont largement contribué à augmenter les surfaces et la fertilité des sols au sens agronomique du terme.
Pour en savoir plus il est possible de consulter la fiche rédigée par l’AGBG sur : cryoturbation, cryoclastie, ainsi que les cours en ligne sur les propriétés du sol et l’altération des roches et l’information sur la pédogénèse.
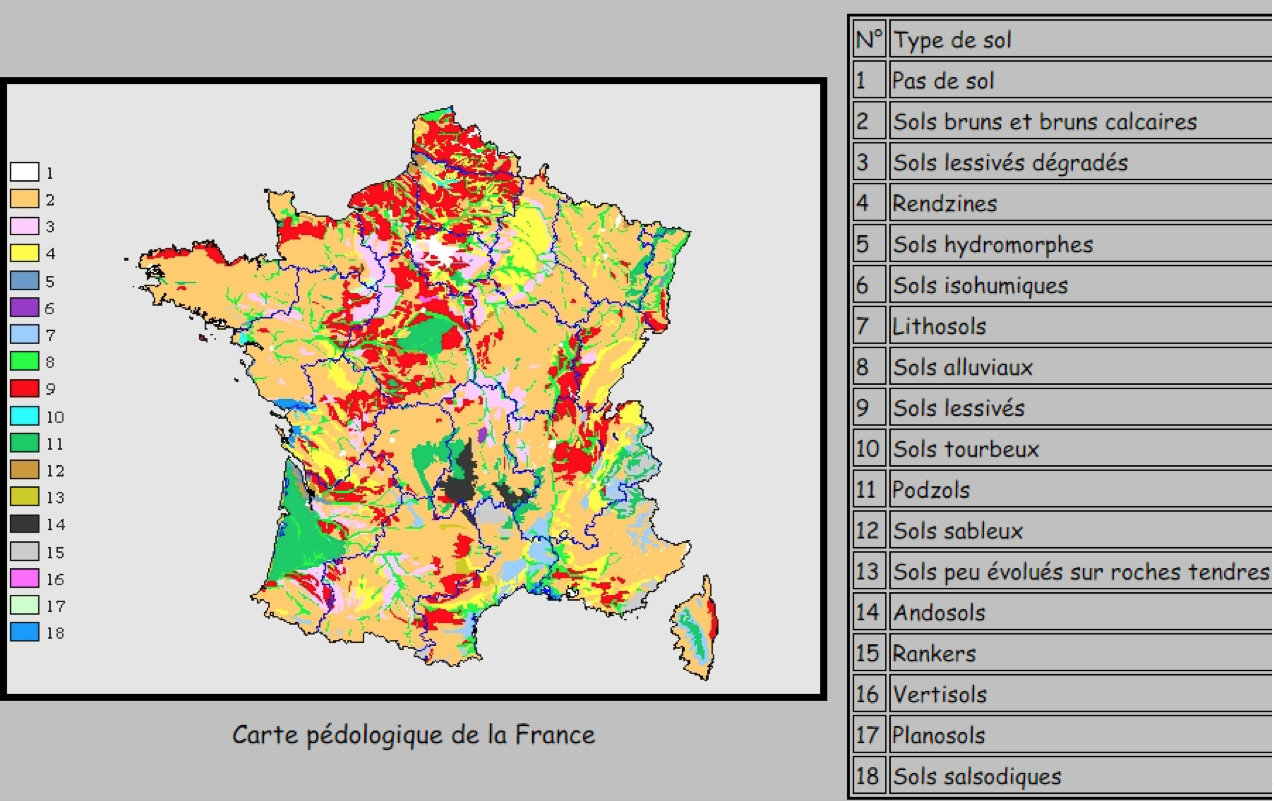
3.4 Le plus grand danger pour les sols : leur « artificialisation » liée au contexte socio-économique :
La France perd l’équivalent de la surface agricole d’un département moyen tous les 8 à 10 ans, sous l’effet de l’urbanisation : béton des zones péri-urbaines, habitations, banlieues tentaculaires, infrastructures de communication, etc.
La rentabilité modeste de l’activité agricole ne peut rivaliser face aux autres usages du sol comme la création d’infrastructures, d’industries, de zones commerciales et urbaines. Dans le contexte français, il est plus facile et beaucoup rentable de céder la terre pour ces usages que de la cultiver ( agence européenne de l’environnement)
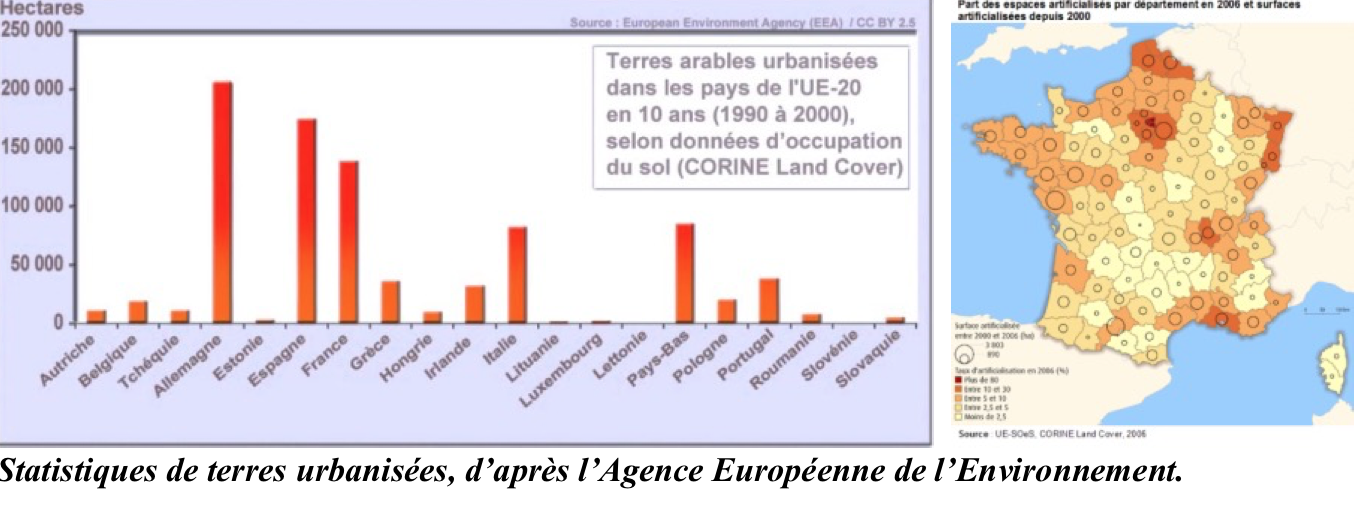
Une autre conséquence de cette distorsion de la rentabilité des usages du sol est l’augmentation de la taille des exploitations : au changement de génération, les héritiers cèdent souvent la terre et les petites exploitations non viables ne trouvent preneurs qu’au travers des structures plus importantes voisines, qu’elles viennent ainsi grossir, sauf si des offres plus avantageuses sont faites et c’est alors de l’urbanisation. (Le contexte socioéconomique provoque donc une accélération de l’artificialisation des terres et au mieux un regroupement des structures d’exploitations).
La mise en place de nouveaux dispositifs réglementaires tend à limiter la poursuite de la dispersion des moyens de production agricole (PLU : Plan Local d’Urbanisme réglementant à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes un projet d’urbanisme et d’aménagement qui en fixe les règles. En outre, il définit la destination des sols indiquant quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc.).
3.5 Le second risque pour le sol est celui de l’érosion.
Le plus spectaculaire est celui de l’érosion du littoral sous l’action des courants marins, du ressac et des marées, mais il n’est pas directement imputable à l’agriculture. (Voir la note d’information de l’IFEN, l’institut français de l’environnement).
Par contre, sous l’action de fortes pluies, le ravinement peut entraîner des quantités importantes de limons vers le bas des pentes dans les situations les plus fragiles. Ces risques sont maintenant relativement bien cernés et des cartographies disponibles. Ils concernent les situations en pente, de textures limoneuses ou sableuses, de sols nus au moment des accidents climatiques (non recouvert par une culture ou une prairie). Les tassements et le rainurage lié au travail du sol dans le sens de la pente (buttage des pommes de terre, passages d’outils, ou traces de roues) ainsi que la grande dimension des parcelles accentuent le phénomène (des débuts de ravines peuvent être constatés, même en sols filtrants comme la craie de Champagne, sur des parcelles de faible pente, mais dont la longueur dépasse 1000 m !).
Les solutions consistent à raisonner la disposition et les dimensions des parcelles (compatible avec les standards de largeurs du matériel utilisé : une illustration est consultable dans la revue Perspectives Agricole N°391 de juillet 2012), le positionnement de talus et de haies, l’adaptation des pratiques culturales, comme la couverture permanente du sol. La difficulté de mise en œuvre de ces solutions est plus d’ordre organisationnel au niveau d’un territoire que technique. Le maintien d’un taux de matière organique du sol dans l’horizon de surface, associé à des pratiques de chaulage des terres sauvegardent une texture grumeleuse (bonne porosité vis-à-vis de l’infiltration de l’eau et cohésion des particules d’argiles en agrégats moins sensibles à la battance et à l’érosion). La présence de matière organique « fraiche » en permanence dans l’horizon de surface (enfouissements réguliers de résidus de culture par exemple) entretient une forte activité biologique qui est favorable à la cohésion du sol (agrégats d’argiles stabilisés par les « mucilages » d’origine microbienne : microfaune) et une méso faune (vers de terre) qui construisent une porosité verticale et une donc une bonne infiltration de la pluviométrie.


Exemple de ravine en sol de limon battant en Picardie
Avril 2009 - Photo JPP

Exemple de lutte contre l'érosion.
Démonstration de la réalisation de mini barrages au moment du buttage lors de la plantation des pommes de terre
(PotatoEurope - 2008 - Photo JPP)
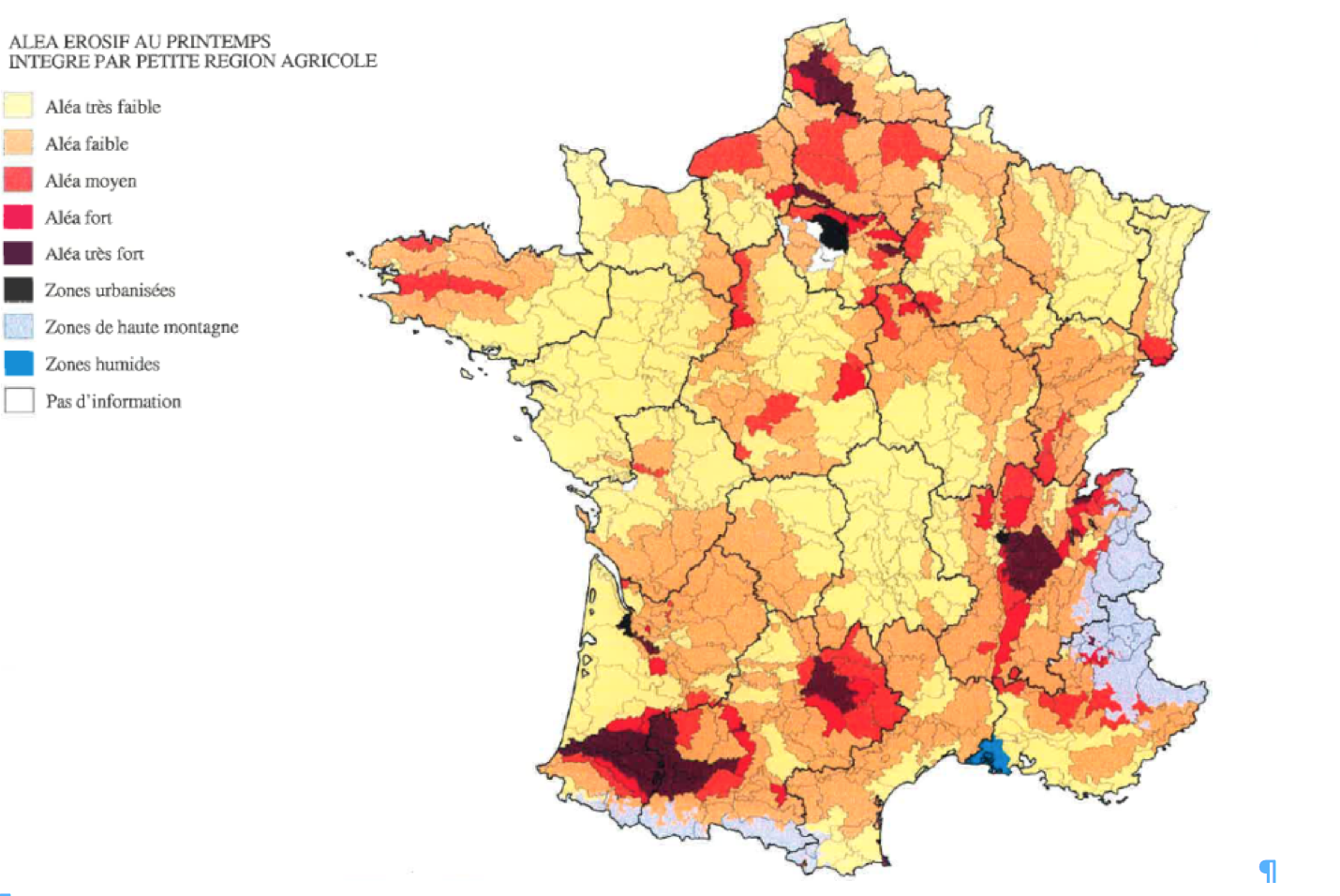
Carte représentant les petites régions naturelles selon leur taux d’exposition aux risques d’érosion
(aléas érosifs – études IFEN)
Voir la cartographie de l’aléa « Érosion des sols » en France par l’IFEN.
3.6 Le tassement des sols peut engendrer des baisses de fertilité, mais il est rapidement résolu en appliquant de bonnes pratiques agronomiques.
Avec l’augmentation de la puissance des tracteurs, les labours ont été régulièrement approfondis dans les années 1950-1970, avec pour conséquence une augmentation des rendements, mais en même temps une certaine dilution de la matière organique des sols. Or, comme dans le cas du problème de l’érosion évoqué ci-avant, les sols sont apparus pour certains plus sensibles au tassement et cela d’autant plus que les matériels employés étaient de plus en plus lourds. La présence de zones compactées en profondeur perturbe le bon enracinement des plantes qui deviennent plus sensibles au stress hydrique et rencontrent des difficultés vis-à-vis de l’alimentation minérale. Les rendements sont alors plus aléatoires. Mais depuis maintenant de nombreuses années, les précautions pour la maîtrise de la profondeur du travail du sol, voir la pratique du non labour dans les situations les plus fragiles, les possibilités de décompactage et l’emploi de pneumatiques basse pression permettent de prévenir les risques de tassement. La vigilance doit rester de rigueur, car le poids des matériels continue d’augmenter et les possibilités d’intervenir en condition de sol plastique (humide) engendrent des tassements qui peuvent atteindre des profondeurs dépassant la couche arable, devenant moins accessibles aux méthodes correctives.
 |
 |
| Exemple de sentier de semi qui ne devrait plus se produire pour éviter de dégrader la structure du sol ? Mais, même dans ces conditions extrêmes, la structure a été récupérée en 2 années seulement. |
Des machines de plus en plus gigantesques |
(Photo JPP)
3.7 L’assimilation des éléments minéraux dans la solution du sol, au travers du fonctionnement du système racinaire des végétaux, provoque inexorablement une lente acidification des sols.
Ce processus concerne encore plus les milieux naturels (forêts, landes), non travaillés, que les sols cultivés. Il est plus marqué en cas de non travail du sol, car l’acidité se trouve alors concentrée dans l’horizon de surface.
C’est pourquoi, depuis l’antiquité, (bien avant que ne soit définie la notion de pH), les agriculteurs ont constaté que la pratique du chaulage, c’est-à-dire l’apport occasionnel de calcaire (marne, craie broyée, maërl marin, sables coquillers…), permettait de maintenir une certaine fertilité des sols. Mais étant donné le poids des apports (plusieurs tonnes à l’hectare tous le 4-5 ans) seules les parcelles à proximité des ressources étaient chaulées. La marne était extraite dans des carrières ou remontée du sous-sol dans des puits creusés à même les parcelles (c’était le dangereux travail du marneur).

Photo : Ancien puits à marne ( Site Criquetot l'Esneval)
Seuls les sols naturellement calcaires n’ont pas besoin d’être corrigés, l’évolution de la roche-mère assurant le maintien d’un pH toujours basique. (Remarque : un sol basique ne correspond pas nécessairement aux conditions idéales pour la croissance de nombreux végétaux, car un excès de calcaire ou un pH trop élevé peuvent être à l’origine d’une mauvaise disponibilité de certains oligo-éléments indispensables aux cultures – les carences doivent être alors corrigées par des apports aux cultures). Les sols sableux ou granitiques sont naturellement acides. Le pH idéal se situe proche de la neutralité (entre 6 et 7). En dessous, de 5 le pH acide provoque des problèmes de toxicité aluminique (les cultures n’ont pas toutes le même niveau de sensibilité). Les pratiques culturales récentes s’appuient sur des analyses de terre pour ajuster ce critère.
Mais l’acidité a aussi des conséquences sur la stabilité structurale du sol : il devient plus sensible à la compaction et à la battance, donc à l’érosion. Les apports organiques et l’enfouissement d’abondants résidus de culture limitent le phénomène d’acidification (pouvoir tampon et notion de capacité d’échange du complexe argilo-humique).
L’assimilation des éléments minéraux engendre naturellement de l’acidification dans l’environnement immédiat des racines et des poils absorbants. Elle provient des échanges des formes solubles (ioniques dans la solution du sol) entre le sol et la racine. Le processus libère des protons dans le milieu (H+) dont la concentration est mesurée par le pH : c’est l’acidification.
Les causes de l’acidification sont multiples. Outre, les causes naturelles liées à l’excrétion d’ions H+ par la rhizosphère évoquée ci-avant (phénomène plus important chez les légumineuses) et au fonctionnement biologique des sols : la minéralisation du Carbone organique, d’autres causes provoquent aussi un abaissement du pH des sols :
- La fertilisation minérale est globalement acidifiante (surtout l’azote ammoniacal).
- Le lessivage des éléments nutritifs et du calcaire.
Elle a aussi pour conséquence de rendre moins disponible les éléments essentiels comme le phosphore, le potassium ou le magnésium.
3.8 Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle en France dans les zones de grandes cultures :
La pratique de la fertilisation minérale et le coût modéré des engrais (phosphate et potasse) ont accompagné la croissance régulière des rendements au cours des années 1960 – 1990. Depuis cette époque, la fertilisation est raisonnée au plus près des besoins des cultures, elle ne vise plus à enrichir le sol, mais à apporter ce qui est strictement nécessaire à l’obtention d’un bon rendement. Les notions d’exigence des espèces et de biodisponibilités des éléments ont été précisées. Elles ont conduit à une réduction sensible de certains apports (voir les statistiques des livraisons d’engrais phosphatés ci-après – ministère de la transition écologique et solidaire) et donc des teneurs jugées excessives dans certaines situations ou pour certains systèmes de cultures. Les agriculteurs suivent régulièrement, au moyen des analyses de terre, l’évolution des teneurs en éléments minéraux de leurs sols cultivés afin d’adapter au plus juste les apports d’engrais qui tiennent compte en particulier des restitutions organiques et des éventuels apports d’effluents (Remarque : le recyclage du phosphore résiduaire face à la raréfaction des ressources mondiales est un enjeu important pour l’agriculture, car les réserves dans ce domaine ne sont pas inépuisables). Voir également l’article sur le site Interactif : « Histoire de la Fertilisation ».
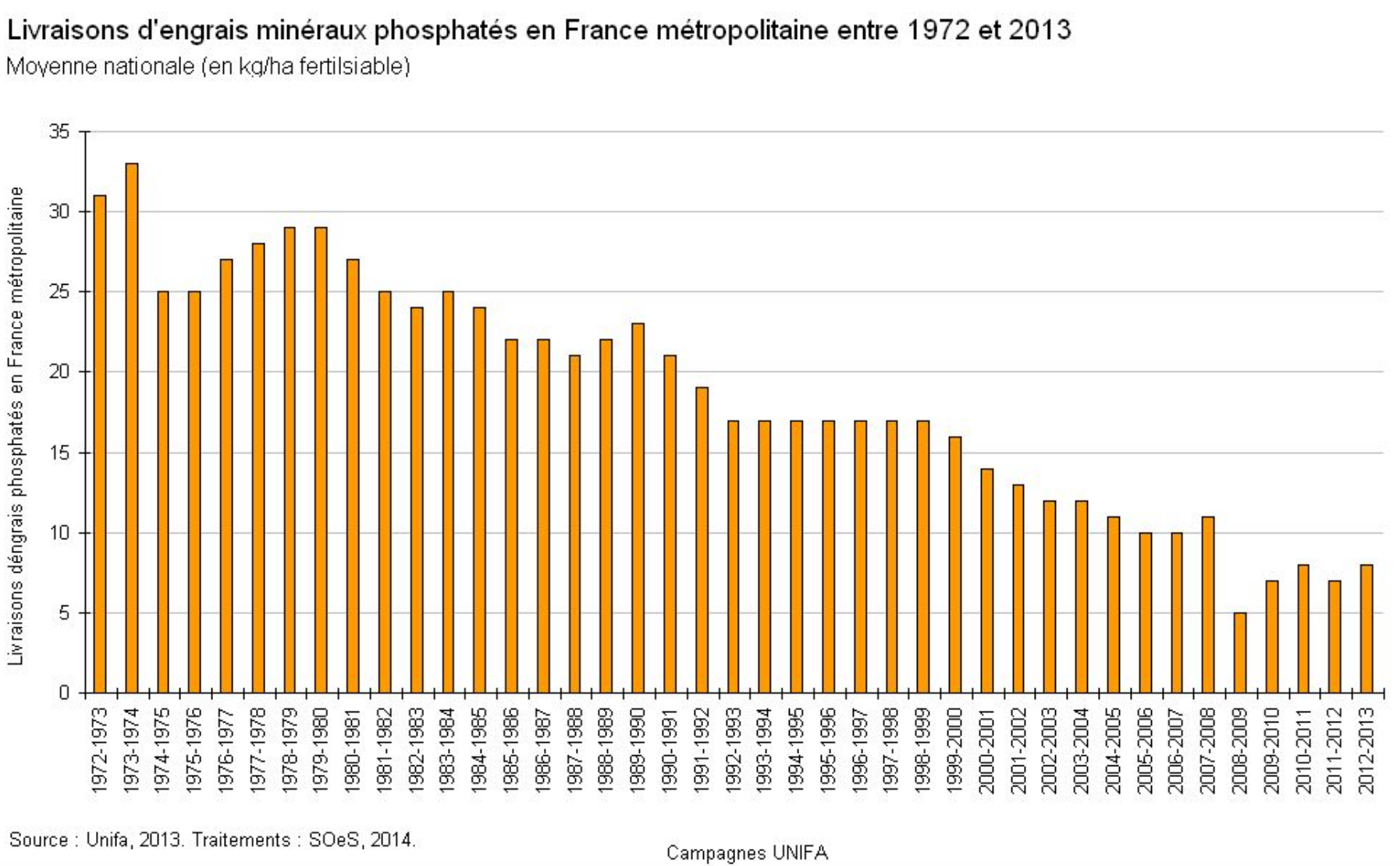
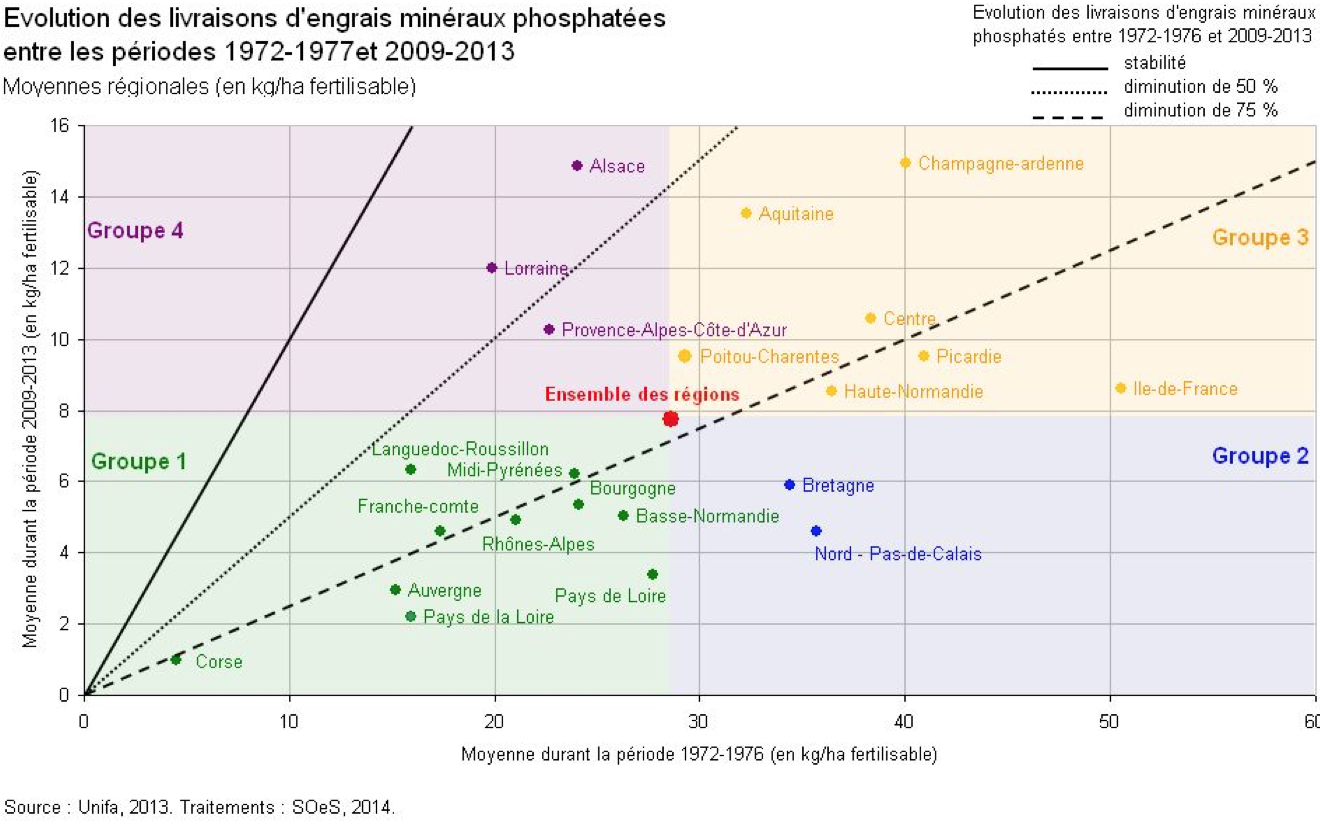
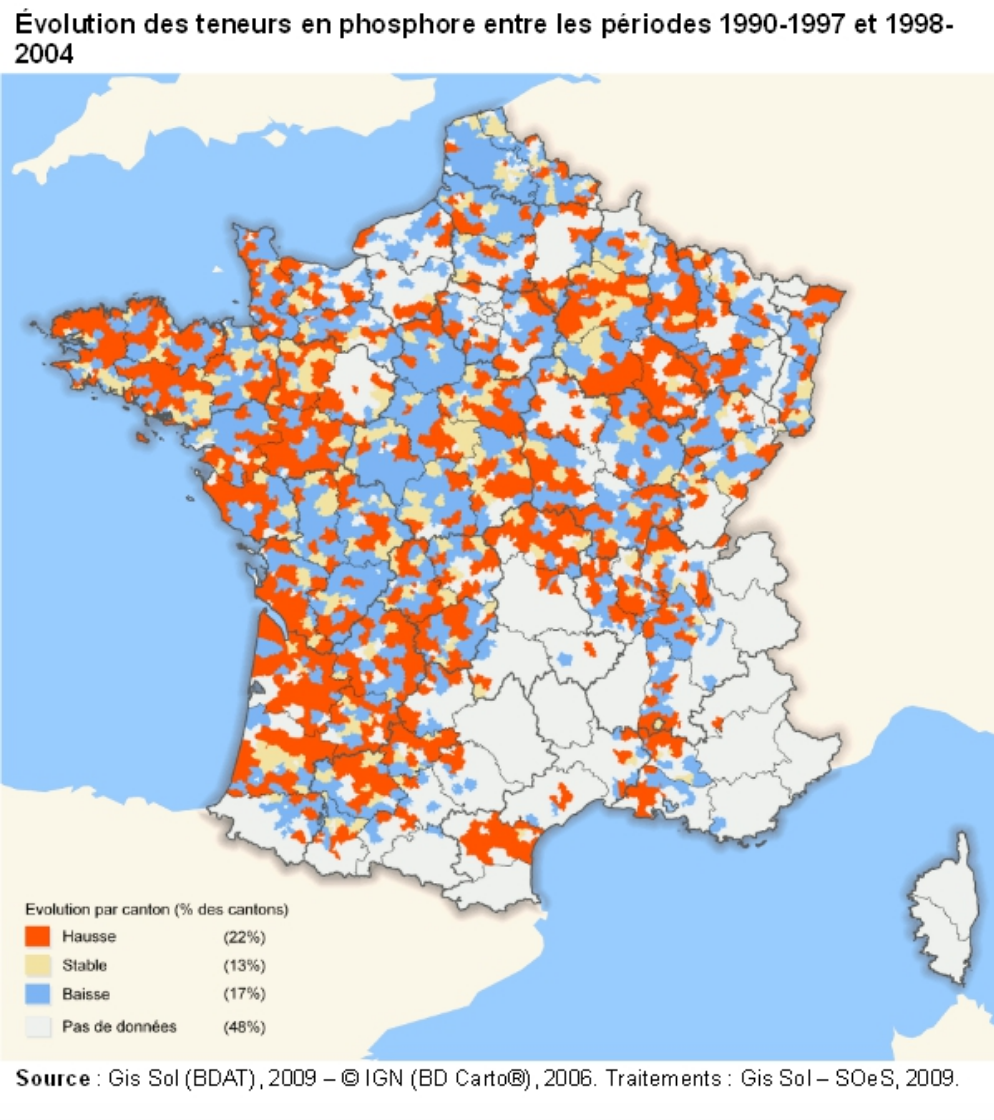
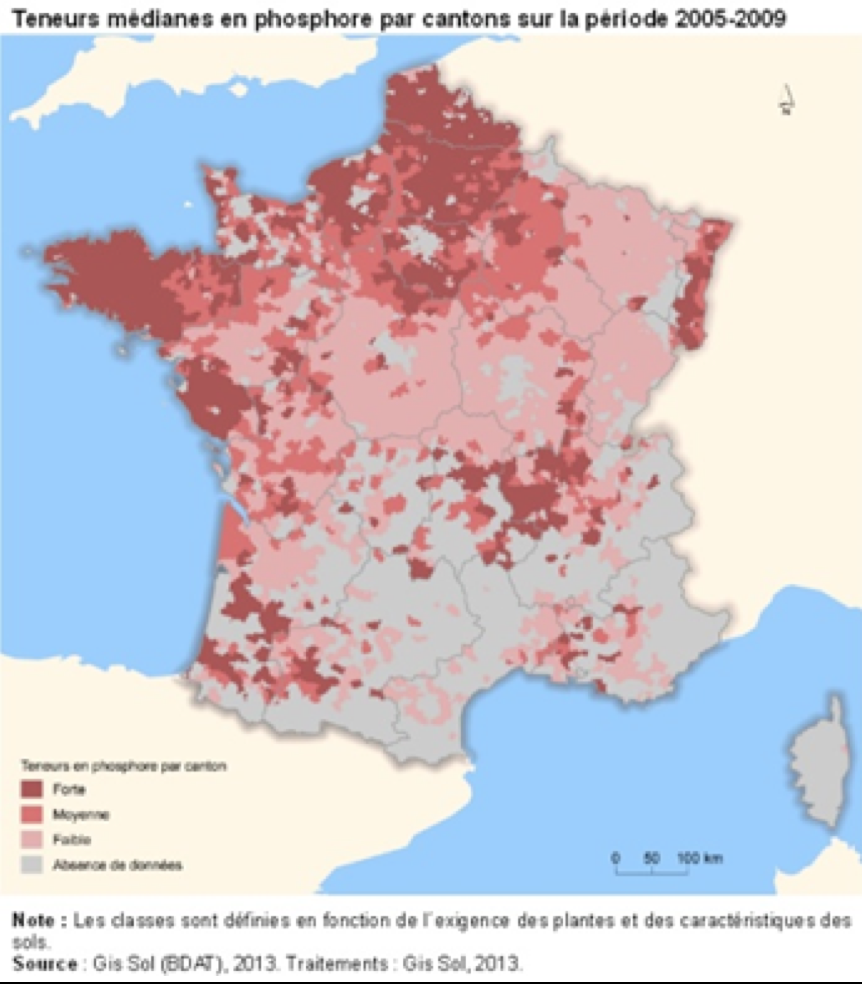
Là où les teneurs en phosphore étaient les plus élevées, elles ont sensiblement diminué entre les périodes 1990-97 et 1998-2004, ce nouvel équilibre correspondrait en définitive à une situation plus « durable ».
3.9 La pollution des sols concerne des surfaces heureusement réduites, mais elle peut être localement préoccupante au niveau de la parcelle
Ces pollutions ne sont pas toujours induites par l’activité agricole. Sous le terme « pollutions » de nombreux risques peuvent être évoqués :
- retombées atmosphériques. Le soufre : s’il est jugé néfaste dans le cas des pluies acides, il est en revanche considéré comme un élément fertilisant pour les cultures, mais en voie de disparition en raison du moindre rejet des fumées industrielles. L’autre cas célèbre est celui des radionucléides provenant de
l’accident de Tchernobyl en 1986
(Est de la France – cf. Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire IRSN) .
- les séquelles de guerre : comme aux abords des usines de fabrication d’explosifs, dans les zones des champs de batailles de 1914-1918, une pollution aux perchlorates a été récemment révélée par les analyses d’eau de la nappe phréatique. C’est la recherche récente de ces polluants dans les analyses qui met en évidence le phénomène 100 ans après les faits de guerre ; elle est jugée sans conséquences avérées pour la santé, mais par prudence, il est conseillé aux femmes enceintes et aux nourrissons de ne pas consommer cette eau.

Obus datant de 1914-1918, déposés en bord de parcelle en attente des démineurs
(Chemin des dames-Aisne-Photo JPP)
- les épandages de boues de stations d’épuration peuvent apporter des micropolluants (plastiques… mais aussi des métaux lourds qui ne se dégradent pas et peuvent s’accumuler : cadmium, chrome, cobalt, cuivre, nickel, plomb, zinc). Tant que les taux restent dans des valeurs basses, ils peuvent être considérés comme des oligoéléments pouvant même contribuer aux besoins de la vie dans le sol et des végétaux, au-delà ils deviennent des polluants qu’il faut suivre dans le processus de recyclage des eaux usées et des ordures ménagères ou des boues industrielles. À noter, que certains engrais phosphatés issus de phosphates naturels sont riches en cadmium. Les transferts par ruissèlement correspondent aux substances adsorbées sur les particules d’argiles et entraînées dans les coulées de boue. C’est surtout le phosphore des lisiers qui fait peser les risques les plus importants : eutrophisation de certaines eaux de surface ou littorales.
La règlementation sur la composition des produits organiques épandus en agriculture et l’obligation de déclarer les plans d’épandage visent à sécuriser cet aspect pour lequel il est nécessaire de rester vigilant (norme NFU 44-095).
- Les produits de protection des plantes ou pesticides peuvent également se conserver plus ou moins longtemps dans les sols. Il est difficile de parler d’accumulation, dans la mesure où le sol joue un rôle important sur la dégradation des produits qui peuvent atteindre sa surface : processus physico-chimiques et biodégradation : détoxification par les plantes et les microorganismes du sol. Des études engagées depuis de nombreuses années commencent à produire des informations pour comprendre les phénomènes en jeu et permettent d’affiner les modalités d’emploi de ces produits.
Les risques identifiés concernent surtout la pollution des eaux de ruissellement ou d’infiltration vers les nappes. La réglementation prend en compte de façon de plus en plus précise ce risque avec le retrait des substances les plus préoccupantes et n’autorise des nouveaux produits que s’ils répondent à des normes toujours plus strictes.
(voir les conseils : AQUAPLAINE © – AQUAVALLE © par exemple).
- Les situations les plus problématiques de sols dégradés, concernent les friches industrielles. L’agriculture n’y est pour rien, mais d’importants travaux sont nécessaires avant une possible remise en état partielle : forêt, parc ou réserve naturelle. Mais il semble difficile de pouvoir les rendre à l’agriculture dans un délai court (quelques années). Plus généralement, le recyclage de tous les déchets devrait contribuer à la poursuite de cet objectif de durabilité des sols.
3.10 Le travail du sol trouve son origine dans la domestication des plantes
Une profonde mutation s’est produite, lorsque l’homme est passé du statut de chasseur-cueilleur à celui d’agriculteur. Dès lors, il a transformé radicalement le sol (la couche arable : horizon de surface travaillé par des outils).
Son objectif premier, il y a environ 8 à 10 000 ans, était de multiplier les plantes intéressantes en ressemant des graines de céréales sauvages. D’abord en fouissant le sol avec un bâton plus ou moins épointé, avant de piocher la terre avec des outils montés sur un manche (la houe). Les premiers succès conduisent à rationaliser cette activité en traînant la houe, d’abord avec des hommes, puis avec des animaux de traits : l’araire était né (IVème millénaire avant JC en Mésopotamie). Cet ancêtre de la charrue fouissait le sol en l’ameublissant, sans le retourner. L’agriculteur moderne continue cette tâche avec des outils de plus en plus sophistiqués, mais son objectif est bien d’améliorer la fertilité de son sol en lui permettant de porter des récoltes toujours meilleures et plus abondantes. Il est possible de se reporter à l’article sur « L’Histoire du travail du sol » sur le site Interactif.
Les moyens modernes d’implantation des cultures permettent d’envisager des méthodes plus complexes, limitant le recours au retournement par le labour, afin de s’approcher d’un statut du sol ressemblant à la situation « antique » avant défrichage. Il est possible maintenant de semer dans un sol encore couvert de végétation (strip-till : travail uniquement de la ligne de semis) et de valoriser, si nécessaire, les effets positifs liés à la présence d’un couvert végétal. La litière laissée en surface, augmente l’activité biologique (par exemple la présence des vers de terre, que certains traduisent par une augmentation de la biodiversité alors qu’il s’agit plutôt d’un indicateur de stabilité vis-à-vis du risque d’érosion).
« L’absence de travail du sol favorise la diversité des espèces présentes. Les perturbations provoquées par le travail du sol modifient les habitats et la localisation des sources alimentaires - donc agit sur ces populations. Elles ont un impact sur l’abondance, la diversité et l’activité des organismes… En tendance, l’absence de travail du sol semble avoir un effet favorable sur la diversité des micro-organismes du sol. Les effets sont plus variables concernant l’abondance et l’activité. La simplification du travail du sol et le non labour permettent d’augmenter la biomasse et l’abondance d'une espèce de vers de terre, les anéciques, qui se déplacent entre la surface et la profondeur du sol. En conséquence, le travail simplifié conduit à la création ou le maintien de la porosité.
L’absence de travail du sol (semis direct / travail très réduit) a également une influence sur la diversité des champignons et des bactéries. Il semble réduire la diversité des bactéries mais augmenter celle des champignons. Ceci semble assez corrélé par le niveau de perturbations induit.
Une perturbation modérée a plutôt pour effet de stimuler la diversité des êtres vivants tandis qu’une forte perturbation ou l’absence de perturbation réduisent la diversité. Mais dans les expérimentations étudiées, les modifications de travail du sol sont le plus souvent associées à la mise en œuvre d’autres techniques (implantation de couverts, apports de produits organiques, rotations). Il est ainsi difficile d’identifier l’effet du travail du sol seul. » (Cf. Alain Bouthier – Colloque Arvalis 2014 Travail du sol).
3.11 Les objectifs du labour sont multiples et s’appuient sur le climat pour la fonction d’ameublissement.
Équipée d’un versoir, l’araire devient charrue. Elle complète les fonctions agronomiques en retournant la terre. Elle se répand en Europe vers le Xe siècle.
Si le labour vise à :
- incorporer les résidus des cultures précédentes et les apports organiques et à favoriser leur décomposition qui participe à l’alimentation des cultures,
- détruire les mauvaises herbes et enfouir les graines indésirables,
- limiter le développement des parasites en perturbant leur cycle : maladies cryptogamiques, ravageurs…
Il s’agit d’abord de créer un lit de semence et un support favorable à l’enracinement des cultures. Et c’est là que le labour, en soumettant le sol à l’action du climat pendant l’hiver, en particulier l’alternance gel-dégel dans les textures argileuses, provoque un affinement de la terre en réduisant les dépenses en énergie.
Les techniques de culture sans labour, pour les plantes qui s’adaptent bien à ce système, économisent encore plus l’énergie en limitant l’effort de traction et en confiant la structuration du sol aux organismes vivants comme les vers de terre. Mais elles ne sont pas possibles pour toutes les cultures et nécessitent un usage un peu plus important d’herbicides.
Enfin le travail du sol stimule la minéralisation de la matière organique et contribue à l’alimentation des cultures, à condition que les apports organiques équilibrent les exportations et se poursuivent sur le long terme.
3.12 La vie biologique qui découle du développement des plantes contribue à la fertilité des sols.
Les phénomènes d’humectation et de dessiccation jouent également un rôle important dans la structuration des sols agricoles (fissuration plus ou moins profonde). L’enracinement des cultures utilise cette porosité et joue un rôle dans sa conservation et dans l’incorporation plus ou moins profonde de substances minérales issues de leur décomposition, ce qui, en définitive, contribue à l’augmentation de fertilité du sol. La présence de matières organiques s’accompagne d’une vie biologique plus ou moins intense : micro-organismes (champignons, bactéries, généralement neutres, parfois pathogènes) et macro-organismes : vers de terre, mais aussi ravageurs (insectes parasites, larves, campagnols, etc.). Un gramme de sol agricole contient entre 100 millions et 1 milliard de micro-organismes… ! Le sol est un milieu vivant et, surtout, l’un des plus grands réservoirs de biodiversité qui existe sur terre. Le travail de l’agriculteur a pour but de gérer des équilibres parfois délicats au niveau du sol entre effets positifs (nutrition des plantes) ou négatifs (parasitisme) pour les cultures.
3.13 Les plantes peuvent s’enraciner à des profondeurs variables, généralement bien au-delà de la zone travaillée du sol.
Alors que le travail du sol concerne les premiers cm proches de la surface (20 à 30 cm maxi en cas de labour), la plupart des cultures peuvent s’installer à plus d’1 m de profondeur : quand la profondeur du sol le permet (avant d’atteindre la roche-mère). Les racines de blé ou de betterave descendent souvent jusqu’à 1.20 – 1.50 m (jusqu’à 1.70 m pour le blé dans la Beauce ), si la pomme de terre ne dépasse généralement pas 60-80 cm, une luzerne s’enracine jusqu’à 5 m de profondeur. Une fois installées (germées) les plantes sont capables de coloniser un grand volume de sol. Des équilibres complexes s’établissent entre les racines et certains microorganismes des sols : bactéries, champignons. Mais la vie dans les sols ne s’arrête pas là ! Il est intéressant de noter que des microorganismes sont encore décelés à plus de 1000 m de profondeur !, mais nous sommes très au-delà du domaine concernant l’agriculture.
3.14 Les rendements élevés ne réduisent pas la fertilité des sols, au contraire ils tendent à l’améliorer.
Contrairement à l’idée reçue, les gros rendements n’épuisent pas la terre.
En effet, lorsque les rendements augmentent (production de grains pour une céréale, de racines pour une betterave, ou de tubercules pour une pomme de terre, etc…), l’exportation des produits récoltés laisse toujours des résidus sur le sol : pailles, racines, feuilles et collets de betteraves, etc. Or le volume de ces résidus est proportionnel aux rendements et vient enrichir le sol en restitutions organiques (avec ou sans la transformation en fumier par un élevage dans le cas du ramassage des pailles). Cette masse organique vient augmenter le pool de matière organique du sol au même titre que les plantes de couverture pendant l’hiver (qu’on appelait autrefois des engrais verts). Donc, à condition de compenser les exportations en éléments minéraux par une fertilisation adéquate, le sol tend à gagner en fertilité avec l’augmentation des rendements.
Mais une très grande richesse en matière organique du sol et par conséquent en éléments potentiellement minéralisables comme l’azote n’est pas sans risques vis-à-vis de la qualité de l’eau : risques de pollution par les nitrates. C’est pourquoi, il est généralement plus facile de conduire les cultures à leur potentiel (permis par le sol et le climat) en ajustant une partie de la fumure au moyen d’engrais minéraux de synthèse et des outils de diagnostic basés sur la connaissance de l’état de nutrition des cultures en cours de végétation. Les situations les plus exposées à cette difficulté sont par exemple : les fortes fumures organiques, les retournements d’anciennes prairies ou la présence de légumineuses mal gérées dans la rotation.
3.15 La simplification des rotations (monoculture ou le faible nombre de cultures dans l’assolement) peut momentanément fragiliser les résultats agronomiques, sans handicaper les futures récoltes en cas de modification.
Remarque : Dans l’interprétation populaire, la notion de rotation est souvent confondue avec celle de la taille des parcelles… En effet, on entend de plus en plus souvent évoquer à tort, les régions de grandes cultures comme des zones où est pratiquée la « monoculture » de blé, de maïs ou même de betteraves dans le Nord de la France (ce qui n’existe pas pour cette dernière culture). Vu de loin, l’espace rural des grandes plaines ouvertes peut apparaître couvert de cultures « monotones » à l’opposé des zones bocagères.
La monoculture consiste à cultiver toujours la même plante, année après années, sur la même parcelle. Les monocultures de blé sont très rares (généralement le blé vient après une plante dite « tête d’assolement » : une plante sarclée ou une légumineuse ou crucifère …). Seuls 2 % des surfaces de céréales à paille en France sont considérés en monoculture, la monoculture de maïs grain est plus fréquente, mais cette dernière ne rencontre aucune difficulté agronomique et n’affecte aucunement les rendements de la culture, ni les propriétés du sol qui tend à s’enrichir en raison des grosses quantités de résidus laissés sur le sol (ce qui n’est pas le cas pour le maïs ensilage où la totalité de la plante est récoltée).
(cf Agreste Les Dossiers n°8 juillet 2010).
La question des rotations, n’est pas nouvelle, elle s’est posée dès les années 1970 avec la pratique de la fertilisation raisonnée basée sur l’utilisation d’engrais de synthèse et surtout l’avènement des possibilités de contrôle des parasites et des mauvaises herbes au moyen de produits de protection de plus en plus performants. Les critères qui nécessitaient une rotation impérative des cultures allaient être bouleversés et la recherche s’est penchée sur cette question. L’I.T.C.F. (Institut Technique des Céréales et de Fourrages) puis Arvalis Institut du Végétal en relation avec l’INRA ont mis en place toute une série d’expérimentations de plus ou moins longue durée et dont certaines sont encore poursuivies depuis plus de 40 ans ! Car, dans ce domaine les effets ne sont pas décelables immédiatement et les études doivent être conduites dans la durée.
Le principe de ces études consistait à comparer diverses successions de cultures sur des parcelles de taille suffisantes, pour être travaillées avec du matériel agricole conventionnel. Un travail de synthèse a été récemment réalisé et fait l’objet d’une publication dans le Courrier de l’environnement de l’Inra n°65, mars 2015 par Irène Félix (Arvalis Institut du végétal).
Sans reprendre ici le détail des résultats de ces études, nous retiendrons que la plupart des cultures, sauf le maïs, voient leur rendement baisser au bout de quelques années quand on les cultive sur la même parcelle. Par ordre de sensibilité croissante à la monoculture, on pourrait donner cette liste : maïs < colza < betterave = blé < pois.
Pour répondre à la notion de durabilité, il est intéressant de noter : lorsqu’on interrompt une monoculture en introduisant une plante de coupure adaptée (par exemple une culture de pois dans une monoculture de blé), on constate un retour immédiat, l’année suivante, d’un rendement totalement comparable à la situation restée assolée.
Les facteurs explicatifs de ces écarts de rendement sont d’abord d’ordre parasitaire et mettent en évidence surtout des maladies ou parasites transmis par le sol (exemples pour le blé : piétin échaudage, helminthosporiose HTR si pailles laissées au sol, fusarioses, … nématodes), mais également un contrôle plus difficile de certaines mauvaises herbes (pour le blé : Ray-grass, brome stérile en non labour, …). Mais d’autres facteurs interviennent et peuvent être interprétés comme une diminution générale de la vigueur des plantes qui se traduit par un système racinaire moins dense explorant moins bien le sol et rendant les plantes plus exigeantes vis-à-vis de l’alimentation minérale (phosphore pour le blé, azote). Mais l’enrichissement du sol en matières organiques (enfouissement des pailles, apport de fumier, pratique des cultures intermédiaires) minimise ces phénomènes.
Une autre façon, d’augmenter la diversité des cultures consiste à mieux gérer les intercultures (périodes entre deux cultures) avec des plantes de couverture variées rendant des services agronomiques (limitation de l’érosion, minimisant les risques de lessivage, faisant interruption dans le cycle de certains parasites, etc.) ou encore en pratiquant des associations d’espèces au sein d’une culture. Ce sont de nouvelles approches qui restent à affiner en grandes cultures, mais utilisées de longue date, car indispensables, dans des systèmes pauvres en intrants (fertilisants, produits de protection).
3.16 La gestion des bords de parcelles est prépondérante par rapport à l’action du travail du sol sur la biodiversité fonctionnelle, critère de stabilité des rendements.
Le maintien d’une biodiversité par la présence de haies et ses abords est réel. Cela permet d’abriter des auxiliaires limitant à la fois les populations de certains ravageurs des cultures (la biodiversité fonctionnelle : celle qui aide l’agriculteur à maîtriser les parasites), mais aussi rentrant dans la chaîne alimentaire d’animaux plus importants : gibier, oiseaux… Des études commencent à être conduites dans ce domaine, elles sont longues et difficiles.
Parmi les premières conclusions on peut noter l’importance des populations de carabes et de syrphes (mouches dont les larves se nourrissent d’insectes) dans le contrôle des populations de pucerons et même des limaces. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’abondance de ces auxiliaires est plus élevée dans les zones enherbées que dans les haies. Les parcelles de cultures ne sont pas le désert que l’on peut imaginer, la mosaïque des cultures pratiquées ou la présence de bois jouent aussi un rôle important. (Il est possible de se reporter à des résultats présentés lors de colloques : « Les entomophages en grandes cultures : diversité, service rendu et potentialité des habitats ».
Voir aussi le projet AuxiMORE.

Implantations de haies en zone de grandes cultures. (Photo JPP)
3.17 Quelques indicateurs de la durabilité des sols ?
- caractérisation des sols (prédiction de la fertilité et conduite durable des cultures) : analyses physico-chimiques (granulométrie, pH, évolution des teneurs en éléments minéraux au cours du temps, taux de calcaire, C/N, ...), profils de sol, résistivité, nouvelles technologies : imagerie de réflectance dans l’Infra Rouge mise en corrélation avec différentes caractéristiques du sol et des cultures, etc…
- estimation de la réserve en eau et gestion de l’alimentation hydrique des cultures (réserves en eau du sol ou accessibles à l’irrigation), aménagements : forages, retenues collinaires… digues, terrasses…
- système de culture : volume de récoltes (ou tonnage produits) à l’ha – tonnage produit par unité travailleur – énergie consommée – revenu de l’agriculteur.
- fertilité mesurée au travers de l’historique des rendements comparée aux moyennes régionales.
Voir également : SYSTERRE® qui permet une analyse exhaustive de durabilité des systèmes de culture
4. LA GESTION DE L’EAU POUR L’IRRIGATION PROCEDE-T-ELLE D’UNE DEMARCHE DURABLE ?
|
Résumé Les surfaces agricoles irriguées en France sont relativement stables, à environ 1,6 millions d’ha, soit à peine 6 % des surfaces cultivées. Toutefois, elles concernent la plupart des cultures. Le recours à l’irrigation s’avère indispensable à la production agricole dans certaines régions, comme le sud et le centre. Grâce à son climat tempéré, la France dispose de ressources en eau bien supérieures à ses besoins ; elles sont estimées à 191 milliards de m3 par an, tandis que les besoins totaux de tous les utilisateurs sont évalués à 33 milliards de m3. L’utilisation agricole représente autour de 10 % de ces besoins. Les ressources mobilisées pour satisfaire ces besoins sont assurés par deux grands types de réserve : les eaux superficielles (27 milliards), présentes dans les cours d’eau et les nappes fluviales associées et les eaux souterraines des nappes profondes (6 milliards de m3). Le développement de l’irrigation et la prise de conscience de l’intérêt d’une utilisation rationnelle de l’eau sont apparus à la faveur d’années particulièrement sèches, au cours des décennies 70 et 80, mais surtout au début des années 90. Dès le milieu des années 60, les Pouvoirs Publics, associés aux Usagers et aux Collectivités Locales ont mis en place des outils de gestion collective de l’eau pour l’irrigation. La Loi sur l’Eau de 1992 a instauré ensuite les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Au début des années 2000, l’Etat Français a transposé le droit communautaire, avec la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, dont l’objectif était d’atteindre « un bon état des eaux » à l’horizon 2015, en assurant la continuité du débit des cours d’eau, et de réduire les sources de pollution. Aujourd’hui, chaque irrigant s’inscrit dans une gestion collective de l’eau qui adapte les volumes utilisables dans son exploitation, en fonction des ressources disponibles au cours de la saison. Dans la plupart des bassins, ces mesures sont admises par les utilisateurs parce qu’elles s’appuient sur des données scientifiques (débit des cours d’eau, niveau des nappes et simulation de leur évolution) et des clés de répartition cohérentes. Toutefois, dans certains cas, en particulier pour les bassins à ressources en eau superficielles limitées et sensibles au déficit hydrique estival (ex du bassin de la Charente), les tensions restent vives entre l’administration, les utilisateurs et les groupes de pression. En parallèle aux mesures de gestion collective, les agriculteurs ont de plus en plus recours à des méthodes et des outils de pilotage de l’irrigation pour le choix de leurs assolements et la conduite de leurs cultures, en particulier grâce aux travaux d’ARVALIS – Institut du Végétal. Vis à vis de la qualité de l’eau, des progrès significatifs ont été réalisés pour limiter les risques de pollution par les engrais et les produits de protection des plantes. L’attention des techniciens et des agriculteurs ne doit toutefois pas se relâcher dans ce domaine. Ainsi, la gestion de l’eau pour l’irrigation, s’appuyant à la fois sur des moyens collectifs et des pratiques raisonnées à l’exploitation, s’avère relever de pratiques durables qui ne remettent pas en cause la disponibilité des ressources. Des efforts importants peuvent et doivent encore être réalisés en particulier dans la constitution de réserves de surface à partir des pluies hivernales. Enfin, les risques d’évolution climatique et la concurrence de plus en plus forte des agglomérations grandissantes nécessitent la plus grande vigilance afin que la gestion des ressources en ressources en eau contribue à la durabilité.
|
L’eau est à l’origine de la vie et nombreuses sont les régions de notre planète qui souffrent d’une mauvaise répartition de l’eau. Les climats, les sols et l’intervention de l’homme sont autant de facteurs qui génèrent des disparités dans la présence de l’eau sur terre.
Pour répondre à la question de la durabilité de l’irrigation agricole, nous nous limiterons au contexte de notre pays, en s’appuyant sur les deux grands types de situation des ressources en eau : les eaux dites de surface, avec comme exemple le bassin versant de la Charente et les eaux dites souterraines, avec comme exemple la nappe de Beauce.
Nous traiterons d’abord des enjeux, puis des moyens mis en œuvre pour assurer une bonne gestion de la ressource. Nous analyserons enfin la durabilité de cette gestion.
A noter toutefois que dans l’imaginaire du grand public, la valeur du bien commun qu’est l’eau dépasse largement les réalités techniques et économiques du sujet et conduit parfois à des positions erronées.
4.1 Les enjeux
Les surfaces irriguées en France, toutes cultures confondues sont relativement stables, depuis le début des années 90 à environ 1,6 million d’ha, soit pas plus de 6 % des surfaces cultivées. Elles ont fortement augmenté entre les années 50 et les années 90.
La plupart des cultures sont concernées, comme l’indique le graphique ci-dessous :
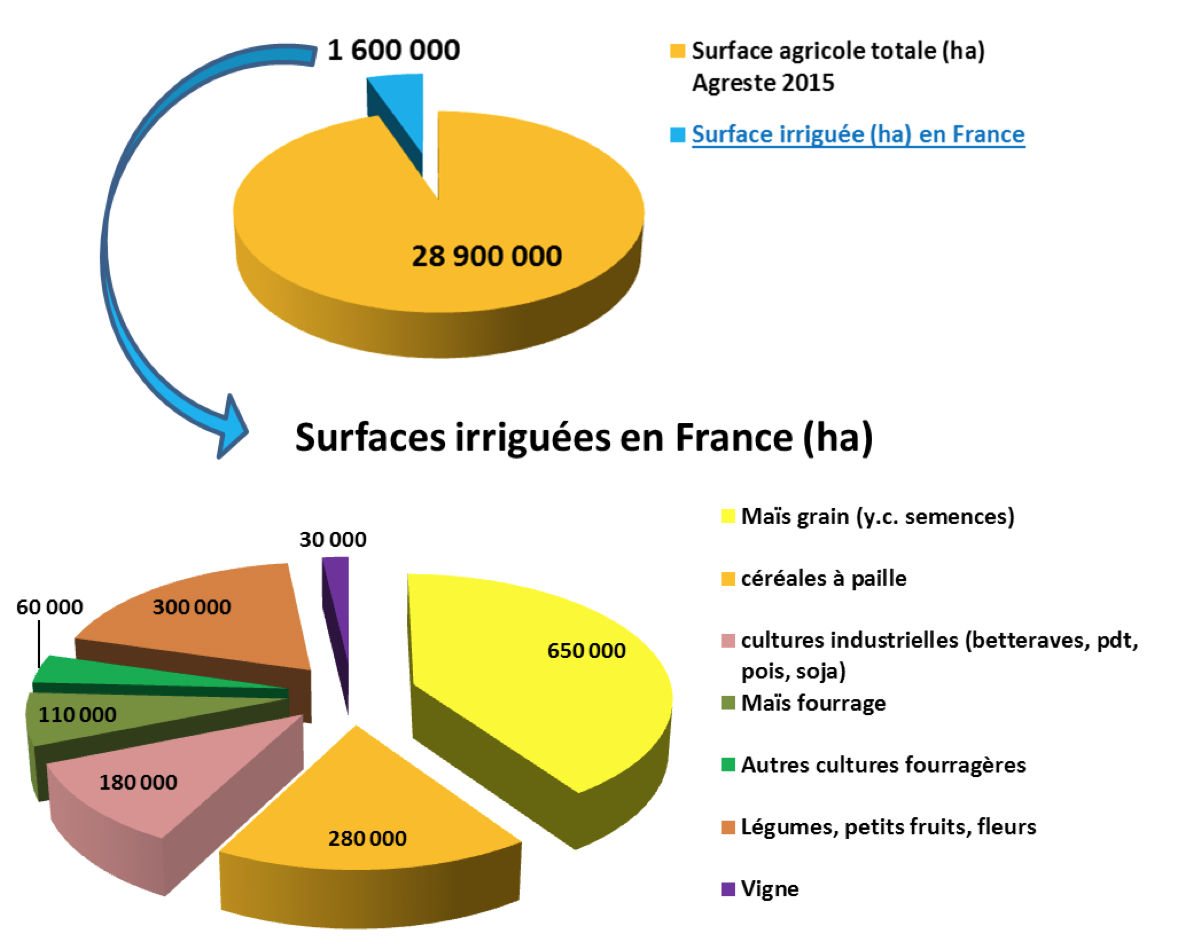
Les ressources en eau doivent être partagées entre plusieurs utilisateurs : agriculteurs, industriels, consommateurs d’eau domestique, activités de tourisme et de loisirs.
Le renouvellement des eaux de surface et des nappes profondes dépend de nombreux facteurs : pluviométrie, topographie, nature du sol, modalités de leur gestion. Une gestion durable doit préserver, voire améliorer les quantités d’eau disponibles, ainsi que leur qualité.
4.1.1 Exemple du bassin versant de la Charente.
Il concerne environ 10 000 ha répartis sur 6 départements. C’est un bassin sédimentaire de faible altitude, exposé au climat océanique. La majorité des terres est issue de l’altération de formations calcaires et de faible épaisseur (Réserve Utile de 50 à 100 mm).
Le fleuve Charente s‘écoule lentement sur 360 km ; ses nappes et celles de ses affluents sont peu épaisses ce qui rend la ressource en eau très vulnérable, tant du point de vue de la régularité du débit que des risques de pollution.
Les précipitations moyennes sont de l’ordre de 800 mm par an, mais avec un déficit estival important de 200 à 250 mm.
Les principales activités concernées par ces ressources sont l’agriculture, la conchyliculture, les industries, les utilisations domestiques, le tourisme et la sauvegarde de milieux naturels remarquables.
L’agriculture.
Dans la majeure partie du bassin, la céréaliculture a remplacé l’élevage sous l’effet du contexte économique au cours des années 90 ; avec elle, l’irrigation s’est fortement développée : entre 1970 et 2000, les volumes d’eau prélevés pour l’irrigation ont été multipliés par 20, atteignant 116 millions de m3, soit 55 % du total des prélèvements d’eau.
80 % des surfaces irriguées sont cultivées en maïs, qui représente, à lui seul, environ 75 000 ha.
Le bassin de la Charente est également le berceau de la production de cognac, dont les vignes couvrent 75 000 ha. Cette production n’est pas irriguée mais sa transformation est consommatrice d’eau comme toute industrie alimentaire.
La conchyliculture
La zone concernée se situe à l’estuaire du fleuve et constitue le bassin de Marennes Oléron ;
60 000 t d’huitres y sont commercialisées, pour un C.A de 200 millions d’€.
Les apports d’eau douce sont indispensables à cette activité, pour l’équilibre entre la température de l’eau, sa salinité et son pH. Selon l’IFREMER, un apport de 12 m3 par seconde (soit environ : 380 millions de m3 par an) est souhaitable pour assurer le développement du phytoplancton, base de l’alimentation de l’huitre.
Les industries
L’agro-alimentaire concerne principalement la production viticole (cognac, pineau des Charentes) et les laiteries.
Le bassin d’Angoulême (chimie, mécanique, électricité, bois …) représente l’autre secteur industriel consommateur des ressources en eau.
Les utilisations domestiques
Dans la région Poitou Charentes, la consommation moyenne d’eau domestique par habitant et par jour est proche de la moyenne française, de l’ordre de 145 à 150 litres.
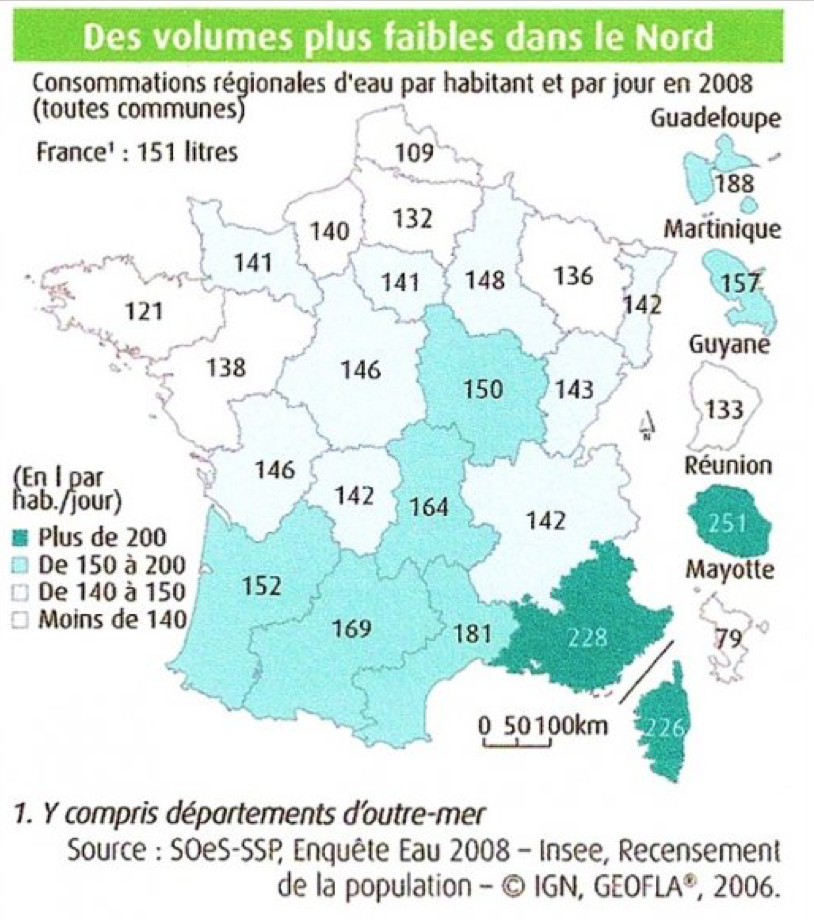
https://www.planetoscope.com/consommation-eau/243-litres-d-eau-consommes-par-un-francais.html
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/en-france/les-usages-domestiques
« Aujourd'hui, chaque Français utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour dans sa vie quotidienne, contre 165 litres par jour en 2004, soit une diminution de plus de 2% par an. (Source : SOeS – SSP-Agreste, enquête eau 2008) »
Le tourisme et les loisirs liés à l’eau
Les enjeux liés au tourisme sont prépondérants. Les zones concernées sont surtout situées près du littoral mais aussi dans les vallées de la Charente et de ses affluents : pêche, baignade, croisières fluviales…
La sauvegarde de milieux naturels remarquables
Ce sont les vallées, les prairies humides, les marais côtiers ; sur les deux départements Charente et Charente Maritime, on dénombre une quarantaine de sites « Natura 2000 », zones protégées où le maintien des milieux naturels est imposé aux propriétaires et aux exploitants.
En conclusion, les enjeux du bassin versant de la Charente sont de préserver une ressource en eau fragile, tant en quantité qu’en qualité, afin de sauvegarder l’économie locale, à travers la diversité des utilisations de cette ressource.
4.1.2 Exemple de la nappe de Beauce
C’est le réservoir d’eau souterraine le plus important de France et d’Europe; il s’étend sur 10 000 km2, entre la Seine et la Loire. Sa capacité de stockage est estimée à 20 milliards de m3, soit 18 fois le volume du lac d’Annecy !
La nappe garantit les besoins en eau pour la production d’eau potable, l’irrigation agricole, l’industrie et l’alimentation des cours d’eau.
Cet immense réservoir est composé de plusieurs couches de calcaire fissuré dans lequel l’eau circule ; les couches sont séparées par des bancs argileux, plus ou moins imperméables. La nappe se recharge en automne et hiver par percolation des pluies.
Trois activités principales se partagent les ressources.
- L’agriculture prélève entre 100 et 300 millions de m3 en fonction de la pluviométrie de printemps et d’été ; un maximum de 450 millions de m3 a été atteint au plus fort de la sécheresse, au début des années 90.
- Les collectivités locales prélèvent en année moyenne 80 millions de m3
- Les activités industrielles (agro-alimentaire, chimie, métallurgie, papeterie, technologies diverses) prélèvent environ 10 millions de m3.
Des conflits d’usage sont apparus à la suite d’une forte baisse du niveau de la nappe au début des années 90, ce qui a conduit les acteurs à mettre en place une gestion collective originale (voir chapitre suivant.)
Par rapport aux ressources de surface, cette nappe souterraine présente trois caractéristiques :
- elle se situe dans une région qui concentre le quart de la population française, avec de très forts besoins en eau potable et pour l’industrie.
- la région concernée a aussi une grande vocation agricole, du fait de la fertilité de ses sols, mais avec une faible pluviométrie annuelle (600 mm)
Cette nappe a la particularité d’avoir une grande inertie et de se recharger lentement.
Les enjeux majeurs sont bien identifiés.
- gérer quantitativement la ressource, afin de maintenir l’économie du territoire
- assurer durablement la qualité de l’eau, car la nappe est soumise aux risques de pollution par les nitrates et localement par des produits phytosanitaires. Les rivières sont également concernées par ces risques de pollution
- préserver les milieux naturels : cours d’eau, zones humides forêts.
- prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement, notamment vis à vis des zones habitées et urbanisées, comme ce fut le cas au printemps 2016.
4.2 Moyens mis en œuvre pour assurer la durabilité
4.2.1 Gestion collective
Historique
La loi sur l’eau de 1964 avait instauré une gestion décentralisée par grand bassin, au nombre de six, sous l’autorité des Comités de bassin composés de représentants des différents usagers, de l’Administration et des Collectivités Locales.
Des Agences Financières, qui deviendront les Agences de l’Eau en 1992, gèrent les redevances et sont chargées de mettre en place des actions d’intérêt commun à tous les usages.
La loi sur la Pêche de 1984 a mis en place une politique de protection des milieux et du patrimoine piscicole, notamment à travers des règles de débit minimum des cours d’eau.
La nouvelle Loi sur l’Eau de 1992, suite aux sécheresses de 1989 et 1990, en affirmant le caractère de l’eau comme Patrimoine Commun de la Nation, a instauré les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Les S.D.A.G.E. fixent les orientations de la politique de l’eau et les objectifs de quantité et de qualité des eaux par grand bassin ; sur la période 2009-2015, leur budget était estimé à 27 milliards d’€, ce qui montre l’importance accordée au sujet !
Les outils de planification par sous bassin sont les S.A.G.E. En 2014, ils étaient au nombre de 178. Ils établissent un plan d’aménagement et de gestion durable, un règlement, des zones de répartition des eaux et des déclarations ou des autorisations de prélèvement à partir de forages ou réservoirs, en fonction de certains seuils.
En 2001, l’Europe a fixé un cadre général avec la Directive sur l’Eau ; l’objectif premier étant d’atteindre un « bon état des eaux » avant 2015, en particulier assurer la continuité du débit d’eau et à réduire les diverses sources de pollution susceptibles de nuire à la salubrité de l’eau.
La loi sur l’eau de 2004 a transposé le droit communautaire en droit français et en 2006 a été adoptée la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).
Cette loi a mis en place des mesures essentiellement destinées à préserver les milieux aquatiques, à assurer la continuité écologique des cours d’eau en affirmant que la gestion équilibrée des milieux devait permettre de satisfaire les exigences de santé et de salubrité publiques. Elle instituait l’obligation pour les irrigants de mettre en place des organismes de gestion collective de l’eau, avec l’instauration des Organismes Uniques de Gestion Collective
Cas du bassin versant de la Charente
C’est l’exemple type où l’équilibre du partage de la ressource en eau est d’une grande fragilité. En effet, il fait l’objet d’un conflit entre les agriculteurs et les « écologistes » qui opposent l’irrigation et la culture du maïs à la préservation des milieux naturels, comme le Marais Poitevin.
Le principe de partage est basé sur la gestion quantitative de l’eau mise en place par les SDAGE.
La situation est toujours restée conflictuelle, sous l’influence des pressions politiques diverses. Un protocole d’accord a été signé en 2011 entre le Préfet de Région et les Chambres d’Agriculture, qui repose sur une baisse générale de l’irrigation estivale, grâce à une évolution des assolements et la création de réserves de substitution.
Toutefois, cette politique continue de faire débat : les associations de défense de l’environnement lui reprochent son coût élevé pour la collectivité et la profession agricole déplore la lenteur et l’obstruction réglementaire, financière et juridique à la mise en œuvre des retenues d’eau.
Dans cette région, la difficulté est liée à la concentration des prélèvements pour l’irrigation en période estivale alors que la pluviométrie hivernale est très excédentaire et part immédiatement à la mer; des syndicats d’irrigants ou des associations foncières ont donc investi dans la création de retenues destinées à être remplie en hiver de manière à soulager les milieux aquatiques durant l’étiage ; malheureusement, ces initiatives voient leur retour sur investissement retardé par des procédures judiciaires permises par les nombreuses contradictions que contient la loi sur l’eau (rapport du sénateur POINTEREAU « Gestion de l’eau : agir avec pragmatisme et discernement » 20 juillet 2016) .
Cas de la nappe de Beauce
Pour résumer l’historique des moyens mis en œuvre au cours des 25 dernières années, une vaste concertation s’est engagée entre les professionnels agricoles, les représentants de l’Etat et les Agences de l’eau.
Pour attribuer à chaque irrigant un volume d’eau, l’originalité a été de s’appuyer sur un programme d’études de modélisation du niveau de la nappe phréatique, engagé en 1998, qui assurait en même temps le maintien d’un débit suffisant dans les cours d’eau associés.
Règles de base de la gestion collective des prélèvements :
- volume maximal prélevable pour l’irrigation : 420 millions de m3 en conditions favorables et 200 millions en année moyenne.
- définition de 4 secteurs géographiques de gestion tenant compte des spécificités hydrogéologiques.
- utilisation d’indicateurs piézomètriques correspondant à la hauteur de la nappe.
- définition de 2 seuils de gestion :
alerte pour le niveau à partir duquel le volume prélevable doit être réduit ;
de crise pour le niveau en dessous duquel aucun prélèvement n’est autorisé. - gestion annuelle des prélèvements en deux temps :
Sortie hiver : selon le niveau de la nappe, attribution à chaque irrigant d’un volume d’eau tenant compte d’un coefficient, en pourcentage de son volume de référence individuel
En cours de campagne, mise en place de mesures de limitation provisoire, au vu des débits des cours d’eau. Ces mesures peuvent se traduire par une interdiction de prélever de 24 à 48 h.
L’ensemble de ce dispositif est cité par les Pouvoirs Publics et la profession agricole (Rapport MARTIN) comme exemplaire dans la gestion durable de la ressource en eau.
Cependant, compte tenu des enjeux économiques liés à la vocation agricole de la région, et aux tensions toujours possibles avec les autres usagers, les Pouvoirs Publics étudient des dispositifs complémentaires et notamment l’intérêt et la faisabilité d’une recharge artificielle de la nappe à partir des eaux de la Loire.
4.2.2 Moyens mis en œuvre à l’échelle individuelle.
Pour mieux gérer les volumes d’eau à apporter sur les cultures
A côté des mesures de gestion collective des ressources en eau, les irrigants utilisent de plus en plus des outils de gestion individuelle et de pilotage de l’irrigation de leurs cultures.
En matière de stratégie d’assolement, les outils développés par Arvalis-Institut du Végétal facilitent le choix de cultures qui optimisent les apports d’eau, tout en respectant les contraintes agronomiques et de faisabilité du travail.
A titre d’exemple, LORA est un outil d’aide à la décision du choix des cultures à irriguer en priorité, afin d’optimiser les apports d’eau.
Concernant la conduite de l’irrigation à la parcelle, beaucoup de progrès ont été faits pour apporter l’eau au plus près des besoins des cultures.
L’utilisation de capteurs associés à des règles de décision agro-climatiques a permis à Arvalis-Institut du Végétal de développer la méthode IRRINOV sur la plupart des cultures irriguées : maïs, blé tendre, blé dur, orge de brasserie, pois, féverole.
Enfin, les campagnes d’avertissements « Irrigation » réalisées par les organismes techniques agricoles sont de plus en plus d’actualité, de même que les méthodes de prévision à l’échelle individuelle de l’exploitation, grâce à l’utilisation grandissante des stations météo et des données enregistrées.
Pour sauvegarder la qualité de l’eau
Le maintien voire l’amélioration de la qualité de l’eau dépend de nombreux facteurs, dont certains sont corrélés directement ou non aux prélèvements. En particulier, les rejets des stations d’épuration deviennent une source de problèmes lorsque le débit de la rivière est insuffisant pour assurer une dilution suffisante des polluants.
Le bon état des eaux, au sens de la Directive européenne cadre, nécessite une certaine continuité du débit des cours d’eau. Il exige aussi un volume d’eau minimum pour maintenir une température compatible avec la vie de la faune aquatique et pour assurer une bonne dilution des rejets.
Concernant les nappes phréatiques, leur niveau a aussi des conséquences sur la durabilité de la ressource, ainsi que sur la recharge des cours d’eau du secteur environnant ces nappes.
La qualité de l’eau est donc largement sous la dépendance de la gestion de tous les prélèvements.
4.3 La gestion de l’eau pour l’irrigation est-elle durable ?
Contrairement à une idée fréquemment énoncée, l’évaporation directe de l’eau d’irrigation ne concerne que 5 à 10% des volumes apportés (colloque Arvalis sur l’irrigation).
L’eau d’irrigation est utilisée par les plantes pour assurer la photosynthèse et maintenir le flux d’évapo-transpiration nécessaire à leur vie ; la fraction non captée est rapidement libérée sous forme de vapeur dans l’atmosphère. C’est la raison pour laquelle les techniques d’arrosage évoluent vers des solutions qui minimisent les pertes, notamment en cas de vent et de fortes températures.
Dans le cas où des apports excédentaires auraient lieu, cette eau percolerait et rejoindrait les nappes les plus profondes, rejoignant très vite ainsi le cycle naturel de l’eau
La seule eau conservée par les plantes est celle constitutive de la matière vivante qui se retrouve dans la récolte et qui participe à la satisfaction des besoins alimentaires. L’irrigation n’a donc pas d’impact sur le cycle de l’eau, au-delà du délai de consommation des produits agricoles.
4.3.1 Des ressources bien supérieures aux besoins.
Globalement, la ressource française en eau est loin d’être menacée. En effet, notre territoire au climat tempéré reçoit environ 500 milliards de m3 de précipitations par an ; 60 % rejoignent l’atmosphère par évapotranspiration (les ETP des cultures irriguées sont incluses dans ce chiffre). Parmi les 40 % restants, 16 % alimentent les cours d’eau et 24 % s’infiltrent dans le sol pour reconstituer les réserves souterraines.
Les ressources annuelles disponibles pour les différents utilisateurs sont estimées à 191 milliards de m3, tandis que les besoins totaux (eau potable, industrie, hydroélectricité, irrigation, autres usages agricoles) sont évalués à 33 milliards de m3, pour la population actuelle.
D’après une étude du Commissariat Général au Développement Durable, l’irrigation représentait, en 2009, 9% des 33 milliards de m3 de prélèvements, soit 3,2 milliards, loin derrière les besoins de la production d’électricité (64 %), l’eau potable (17 %) et l’industrie (10 %).
Les prélèvements sont assurés par 27 milliards de m3 d’eaux superficielles et 6 milliards de m3 d’eaux souterraines. Les eaux souterraines alimentent prioritairement la consommation en eau potable (les 2/3 environ de 6 milliards). Ces prélèvements sont toutefois inégalement répartis sur le territoire.
4.3.2 La durabilité des prélèvements dépend du type de ressources
Pour les eaux de surface et les nappes superficielles, les volumes prélevables sont définis de telle façon que les seuils de crise soient rarement atteints. Ces volumes sont partagés entre les agriculteurs en fonction des clés de répartition négociées entre eux, de manière à permettre à chacun de gérer un volume prédéterminé et conforme à ses besoins.
Les ressources utilisables peuvent être complétées par des réserves constituées en hiver, en période de hautes eaux.
Ces prélèvements n’ont donc pas d’impact sur le débit des cours d’eau et peuvent donc être considérés comme durables.
Les prélèvements en nappe captive n’ont, quant à eux, pas d’incidence sur le débit des cours d’eau.
4.3.3 Une volonté commune des différents utilisateurs
Depuis les années 60, les agriculteurs et leurs organisations professionnelles ont composé avec les Pouvoirs Publics pour mettre en place des systèmes de répartition et d’utilisation de l’eau permettant d’améliorer la gestion de l’irrigation et d’en assurer la pérennité.
Les différentes étapes de ce cheminement commun se sont déroulées avec plus ou moins de difficultés mais toujours avec le souci de concilier au mieux les différents usages de la ressource en eau. Cela s’est avéré plus facile dans le cas des nappes profondes qui sont moins fluctuantes que les ressources superficielles.
4.3.4 Des progrès significatifs et constants dans la gestion de l’eau au niveau individuel.
Depuis le début des années 90, marquées par des périodes de sécheresse intense, les irrigants ont bénéficié des recherches sur la valorisation optimale de l’eau par les cultures, sur les équipements (aspersion, goutte à goutte …) ainsi que sur la conduite de l’irrigation.
De même, des progrès tangibles ont été acquis en matière variétale sur la tolérance des plantes à un déficit hydrique.
Depuis 1990 les superficies irriguées sont relativement stables soit 5,8 % des surfaces cultivées.
Les volumes prélevés sont passés de 5 milliards de m3 en 2000 à 3.2 milliards de m3 en 2012 avec un maximum de 5.5 milliards de m3 en 2003 (source : Agences de l’Eau - ministère de l’environnement). Une tendance à la baisse s’observe depuis le début des années 90 et s’explique par la diminution de l’irrigation gravitaire, par l’évolution des connaissances des besoins des plantes, l’amélioration génétique, l’avènement de nouveaux équipements ainsi que le coût de l’eau qui incite à la recherche de l’efficience maximale des apports..
4.3.5 Mais l’irrigation est coûteuse en énergie
Dans ce domaine, de très gros progrès ont eu lieu durant les 30 dernières années : l’essor des surfaces irriguées a permis de financer une recherche sur les améliorations des matériels de pompage et des matériels de distribution. On dispose aujourd’hui de pompes capables de réguler leur montée en puissance, moins consommatrices d’énergie, et d’ajuster en permanence leur débit, donc leur consommation, en fonction des régulations de débit au niveau de la distribution.
Les appareils de distribution d’eau sont également de moins en moins consommateurs d’énergie. Les pivots et les rampes d’aspersion sont plus économes que les enrouleurs mais plus exigeants quant à la forme du parcellaire. On commence à étudier les possibilités de la micro-irrigation en grandes cultures avec la consommation d’énergie comme l’un des objectifs. Aujourd’hui, la consommation énergétique de l’irrigation est de l’ordre de 0,4 à 0,6 kW/m3 selon le matériel utilisé et les caractéristiques du pompage et du terrain.
En fonction du type d’installation (canon enrouleur ou pivot), les charges totales de l’irrigation avec un matériel en cours d’amortissement se situent aux environs de 300 €/Ha et par an, à mettre en regard avec la perte de rendement si la culture n’est pas irriguée. A l’heure actuelle, les charges totales des installations de micro-irrigation sont de l’ordre de 700 à 800 €/Ha et par an et ne se justifient donc que pour des productions à haute valeur ajoutée.
Des études réalisées aux Etats-Unis indiquent qu’un maïs irrigué avait un rendement énergétique net supérieur et émettait moins de gaz à effet de serre par unité de grain produite qu’un maïs cultivé en sec qui, certes nécessite des moyens de productions moindres, mais présente un rendement moins important.
4.4 Conclusion : les défis à venir
Les défis que les acteurs professionnels et publics ont à affronter sont de répondre toujours mieux aux différents utilisateurs, dans un cadre concurrentiel de l’aménagement du territoire, entre les agglomérations et les territoires ruraux, ainsi que dans un contexte évolutif du climat, qui pourrait accroitre sensiblement les besoins en eau d’irrigation.
Les réflexions conduiront vraisemblablement à trouver un compromis entre la poursuite des politiques actuelles d’une part, comme la gestion collective et la création de ressources nouvelles et la mise en œuvre d’autre part de stratégies d’adaptation des assolements pour utiliser moins d’eau (amélioration génétique, choix des espèces, généralisation des outils de pilotage)
Le Centre d’Analyse Stratégique pour une politique préventive de la ressource en eau recommandait, dans un scénario prospectif de 2013, « la chasse au gaspillage, l’amélioration de la productivité de l’eau dans les systèmes agricoles et une politique de stockage de l’eau »
Le stockage de l’eau fait indéniablement partie des solutions qui permettront à l’irrigation d’apporter une contribution durable à l’agriculture.
Citons, par exemple le Président d’Aquanide, l’association des irrigants de Poitou Charentes :
« En janvier 2016, il est tombé 110 mm d’eau sur la région, soit 2,9 milliards de m3 sur 25800 km2 ; or, les besoins pour l’irrigation étaient de 260 millions de m3, soit 10 fois moins que la pluviométrie d’un seul mois d’hiver !"
A côté des ouvrages classiques de stockage de l’eau, il existe d’autres méthodes :
- La recharge pilotée de nappe est un soutien à une nappe souterraine, avec des avantages à la fois quantitatifs et qualitatifs. Plusieurs moyens techniques existent et sont déjà utilisés dans le monde : méthodes d’infiltration dans des terrains perméables, méthodes d’injection par forages ou pompages. Ainsi, les eaux de la Loire pourraient être utilisées, via la recharge artificielle des aquifères, pour assurer le maintien des niveaux de la nappe de Beauce.
- La récupération des eaux pluviales ou la réutilisation d’eaux déjà utilisées sont également des méthodes à l’étude, voire déjà opérationnelles ; par exemple, l’association Limagne Noire utilise depuis les années 90 des eaux usées traitées pour irriguer 700 ha de maïs.
Ces méthodes prometteuses sont toutefois sous la coupe de la réglementation qui n’évolue que lentement.
Ce tour d’horizon de l’irrigation, à travers notamment deux régions aux ressources en eau très différentes, montre que les stratégies adoptées par la Profession Agricole et les Pouvoirs Publics relèvent, malgré les difficultés liées à la concurrence sur les disponibilités en eau, de réflexions et de démarches qui vont dans le sens de la durabilité des pratiques agricoles.
Face à d’immenses défis au niveau mondial, notamment à cause de l’inégale répartition de l’eau, la France, grâce à ses ressources et son climat, bénéficie aujourd’hui d’une situation enviable.
Toutefois, les risques d’évolution tant climatique que d’aménagement du territoire avec un déséquilibre croissant entre villes et campagne nécessitent la plus grande vigilance pour maintenir, à l’avenir, cette durabilité.
Références bibliographiques
- Durabilité des pratiques agricoles : Etat des lieux et évolutions.
Arvalis - Institut du végétal, Avril 2015 - Le bassin versant de la Charente : une illustration des problèmes posés par la gestion quantitative de l’eau. C.BRY et P. HOFLACK
Courrier de l’Environnement INRA N°52 Septembre 2004 - La gestion de l’irrigation sur la nappe de Beauce, SAGE Avril 2016
- Fiche d’identité de la nappe de Beauce, historique et enjeux. SIGES Centre Val de Loire
- Comprendre l’irrigation en agriculture, dix clés. J.P. RENOUX et A. d’ARMAILLE. Octobre 2016
- Controverse documentée à propos de quelques idées reçues sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Episode n°3.
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux - Avril 2014. - Gestion des ressources en eau : quelles perspectives pour l’irrigation. B. LACROIX et P. CABEZA-ORCEL Perspectives Agricoles Décembre 2017.
|
Eaux superficielles et eaux profondes : L’eau douce se partage entre plusieurs compartiments qui relèvent de dynamiques différentes :
Les eaux de surface constituent le réseau des fleuves, rivières et ruisseaux ; leur écoulement est rapide et leur niveau varie de manière importante selon les épisodes pluvieux au cours de l’année. Les nappes profondes libres rejoignent les eaux de surface ou des nappes captives ; elles ont un écoulement plus lent, sur une distance plus longue. Elles alimentent donc le débit des rivières de manière décalée dans le temps, ce qui assure le débit d’étiage ; elles se vidangent annuellement et de ce fait, leur niveau varie lentement sur l’année, avec un minimum en septembre et un maximum en mars. Les nappes captives restent prisonnières des sédiments qu’elles occupent ; elles se remplissent à l’affleurement de la strate géologique qui les abrite et leur niveau varie peu. Les impacts des prélèvements dépendent du compartiment d’où les eaux proviennent. En nappe superficielle, les prélèvements peuvent avoir un effet immédiat sur le débit des cours d’eau ; c’est au regard de cette incidence que sont prises les décisions de les réduire ou de les arrêter, lorsque les seuils de niveau de rivière sont franchis à la baisse. En nappe profonde libre, l’impact des prélèvements est différé dans le temps, mais la vitesse de l’écoulement et donc de la vidange dépend de la différence de niveau entre l’amont et l’aval de la nappe. Ce niveau peut être fortement affecté par le défaut de remplissage à l’aval. En particulier, les villes, avec leurs sols imperméabilisés et leur situation fréquente en vallée et à la confluence de plusieurs cours d’eau, qui empêchent l’infiltration de l’eau, sont un facteur d’accélération de la vidange des nappes ; cela explique que certains ruisseaux qui avaient autrefois un écoulement continu sont devenus intermittents. Dans les nappes libres, les prélèvements ont un impact plus modéré qu’en eaux de surface. Dans les nappes captives, les prélèvements n’ont aucun impact sur le débit des cours d’eau.
|
|
Une France qui s’assèche La sécheresse représente plus de la moitié du coût total des calamités agricoles liées aux accidents climatiques, qui s’élève en moyenne à environ 600 millions €/an, sur les quinze dernières années. A terme, le sud et le centre du pays seront les régions les plus touchées par le réchauffement climatique et le déficit pluviométrique. Le rapport CLIMATOR (A.N.R/I.N.R.A.) annonce des baisses croissantes de l’humidité des sols au début du printemps, période cruciale pour les cultures. De même, le rapport CLIMSEC de Météo-France craint des sécheresses agricoles extrêmes sur la majeure partie du territoire avant la fin du siècle. D’après G. BENOIT et H.PIATON, corédacteurs du dernier rapport du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux, stocker l’eau est une condition « sine qua non » pour continuer à produire des denrées agricoles dans les conditions de diversité et de proximité actuelles. D’après B. LACROIX et P. CABEZA-ORCEL, Perspectives Agricoles Décembre 2017 |
5. LA PROTECTION DES PLANTES, INCONTOURNABLE DANS LA DURABILITE DE L’AGRICULTURE
|
Résumé La protection des cultures contre le parasitisme est un élément indispensable de l’itinéraire cultural de l’agriculteur, ceci quel que soit le système de culture mis en œuvre (conventionnel, agriculture de conservation, « bio », agroécologie…). L’agriculteur lutte contre le parasitisme à double titre : pour limiter au maximum les pertes de rendement liées à l’action du parasite, mais également pour éviter les dégâts de type qualitatif et sanitaire dépréciant sa production. La mise en œuvre de la protection de ses cultures repose sur une double approche de la part de l’agriculteur, consistant en une attitude préventive qui vise à limiter le développement du parasitisme et une action curative qui vise à éliminer le parasite encore présent sur ses parcelles. C’est en essayant de combiner au mieux ces deux piliers de la lutte contre les parasites qu’il est possible d’envisager une durabilité de la production agricole L’équilibre n’est pas aussi facile à trouver qu’il n’y parait et ceci quelle que soit la conduite de culture adoptée. En effet, la plupart des techniques préventives ont l’inconvénient de limiter le potentiel de rendement et par voie de conséquence la rentabilité économique de la production. De l’autre côté, l’action directe sur le parasitisme implique la mise en œuvre, soit d’une main d’œuvre importante (par exemple, désherbage, binage, ramassage d’insectes quand c’est possible…) et donc un coût de production important, soit l’application sur la parcelle de substances ou d’organismes permettant d’éliminer le parasitisme à combattre. Dans ce dernier cas de figure l’inconvénient majeur réside dans un effet négatif possible suite à l’introduction d’un xénobiotique sur la parcelle. Cet effet peut impacter l’ensemble des compartiments de l’environnement y compris l’homme, et ceci indépendamment de la nature de l’organisme ou de la substance, qu’elle soit d’origine de synthèse (contrôle chimique) ou d’origine naturelle (biopesticides). L’élément clé de la durabilité de la production agricole de demain réside dans l’utilisation d’espèces et de variétés moins sensibles au parasitisme. La génétique, avec les progrès considérables des nouveaux outils du domaine des biotechnologies, constitue aujourd’hui le levier essentiel permettant de réduire efficacement l’utilisation de substances chimiques. C’est également l’élément incontournable qui permettra une mise en œuvre économiquement rentable du biocontrôle, dont les produits sont aujourd’hui moins efficaces que les produits issus de la chimie, plus compliqués à mettre en œuvre et souvent plus coûteux. Une approche objective de la protection des cultures pour une agriculture durable, plaide aujourd’hui pour une utilisation diversifiée des moyens mis en œuvre, compte tenu des avantages et des inconvénients des différentes techniques de protection. Encore faut-il s’extraire de l’idéologie actuelle s’exprimant à tous les niveaux de notre société, laissant croire à d’hypothétiques différences entre chimie de synthèse (les pesticides actuels) et chimie naturelle (le biocontrôle). Il ne peut y avoir de durabilité de l’agriculture sans rentabilité de l’activité agricole. La protection des cultures est un élément essentiel de la rentabilité d’une ferme. Il est donc impératif de mettre en œuvre des moyens et des outils de protection des plantes efficaces et économiquement rentables, à travers une diminution du parasitisme et la mise en œuvre de solutions de nature chimique ou biologique. C’est grâce à la science, à la technologie et à l’amélioration des techniques que l’on pourra utiliser des outils irréprochables tant sur le plan de leur impact sur l’environnement que sur le plan de la santé humaine.
|
5.1 Pas de durabilité sans protection des cultures
Les techniques de protection des cultures ne constituent pas un facteur de production comme pourrait l’être l’engrais que l’on apporte aux plantes. En effet la fertilisation permet de nourrir les plantes pour approcher le potentiel de rendement permis dans un milieu et sous un climat donné, alors que la protection de la plante contre le parasitisme (adventices, maladies, ravageurs) permet de maintenir ce potentiel en évitant les pertes occasionnées par les nuisibles.
Ainsi en absence de parasitisme, la culture peut exprimer son potentiel lié à la variété et aux autres techniques culturales, au sol et au climat. Par contre, le potentiel de rendement ne peut être atteint que si la plante est indemne de parasites. Il est possible de diminuer le niveau ou la pression du parasitisme par la mise en œuvre de certaines dispositions culturales comme les rotations longues et diversifiées, la date de semis ou la moindre sensibilité (aux maladies) des variétés. Mais en général ces techniques impactent négativement le potentiel de rendement.
Ces solutions de protection des cultures peuvent être assurées par l’application de produits de synthèse ou d’origine naturelle (les plus répandues et les plus efficaces aujourd’hui), biologiques (souvent très sophistiquées comme la confusion sexuelle), mécaniques (herses étrilles pour le désherbage par exemple, robots) ou manuelles (binage, ramassage des chenilles, insectes…).
En 1990 on estimait que les pertes de récolte mondiales liées au parasitisme étaient encore de 51% pour le riz, 41% pour la pomme de terre et 34% pour le blé… (NEVEU A. (2009), Nourrir le monde en 2050. Les voies et les moyens pour accroître la production agricole mondiale - Rapport de l’Académie d’Agriculture de France.) Plus près de chez nous, le carpocapse qui entraîne la production de pommes véreuses provoque des pertes de quelques % à 100% de la récolte (2). Arvalis Institut du végétal estime que les seules maladies foliaires du blé d’hiver provoquent des pertes de rendement de l’ordre de 17.5 q/ha en moyenne (VERJUX N. & col. (2017), Protection intégrée en grandes cultures. Réalités et perspectives. AFPP-COMMAPI).
Outre l’effet sur le rendement, le parasitisme impacte également la qualité des produits récoltés entraînant des difficultés plus ou moins importantes de commercialisation voire des produits non commercialisables. C’est le cas de la Pyrale du maïs par exemple : la chenille qui perfore la tige de la plante entraîne le développement de moisissures qui produisent des mycotoxines « toxiques » dont la LMR (Limite Maximale de Résidus) dans la récolte est strictement encadrée. Les Fusarioses se développant sur les épis du blé provoquent également la production de toxines. Les galeries creusées dans la pomme par les chenilles de Carpocapse favorisent l’installation de champignons qui, au-delà du fait que les pommes sont invendables, entraîne la production de patuline, une mycotoxine « toxique » rendant le jus de pomme non commercialisable si les teneurs dépassent les LMR. Et que dire du mildiou de la vigne qui, lorsqu’il se développe tardivement, entraîne une acidité accrue des moûts, une baisse de la teneur alcoolique, autant de problèmes qui compromettent fortement l’aptitude des vins à la conservation.
On pourrait multiplier les exemples montrant que limiter voire supprimer la protection des cultures sous couvert de « durabilité » amène à des impasses dont l’agriculteur et le consommateur seraient les premières victimes (baisse de production, de qualité, raréfaction de la denrée et augmentation du prix).
C’est sur ces constats et grâce à une recherche active, que la lutte chimique contre les parasites s’est développée quantitativement (nombre d’ha traités et nombre de traitements / ha) et qualitativement (nombre de molécules et efficacité des traitements) au cours des cinquante dernières années.
Ce contexte de développement de la lutte chimique a fait émerger la question de la « durabilité » qui s’est posée en des termes plus particuliers :
- quelle est la dissémination des résidus de traitement dans le milieu (sols, eaux, air, faune, entomofaune…),
- quelles quantités de résidus de traitements se retrouvent dans les denrées alimentaires et quelles en sont les répercussions sur la santé du consommateur,
- quels sont les risques pour la santé des applicateurs, en contact direct avec les produits de traitement.
Dès lors tous les acteurs de la protection des cultures se sont concertés pour permettre une amélioration de la durabilité de l’activité et de la production agricole. Dispositions réglementaires, recherche, conseil des services techniques et agriculteurs ont fait converger leurs efforts.
Citons par exemple :
- la généralisation des zones tampon, ZNT (zones non traitées) et l’implantation de bandes enherbées pour éviter la dissémination dans l’environnement
- les réaménagement paysagers (haies…) permettant de favoriser la biodiversité (auxiliaires des cultures…) pour limiter la pression de certains ravageurs.
- la suppression des molécules au profil toxicologique et éco-toxicologique défavorables
- l’apparition, à l’inverse, de molécules aux profils plus favorables, que ce soit en matière de toxicologie ou d’écotoxicologie
- la réduction des quantités de matière active utilisées par l’agriculture (on est passé de 110.000 t de produits appliqués en France à la fin des années 1990 à 65.000 tonnes aujourd’hui)
- la mise en œuvre par les applicateurs de solutions de protection individuelle performantes (filtres à air des cabines de tracteur, masques, gants, survêtements protecteurs…)
- la mise en œuvre par les agriculteurs de méthodes de lutte raisonnée s’appuyant sur l’utilisation de méthodes de prévision du développement du parasitisme, de systèmes d’observations (utilisation des données météo), d’alertes permettant d’intervenir au bon moment et là où c’est nécessaire en évitant les interventions inutiles.
- …
|
L’utilisation des « biopesticides » est-elle plus durable ? Dans l’évaluation de la durabilité des pratiques agricoles conventionnelles, il faut bien avoir conscience de l’importance considérable du chemin parcouru par l’agriculteur pour limiter les éventuels effets négatifs de la lutte chimique. Il faut le rappeler avec force à une opinion publique, manipulée par les discours d’ONG sans aucun fondement scientifique sérieux et régulièrement repris, pour ne pas dire facilités, par la quasi-totalité des médias du pays. Notons également qu’il est totalement irrationnel d’opposer les effets négatifs des produits chimiques ou de synthèse sur la durabilité de l’agriculture aux substances naturelles ou aux techniques biologiques :
D’autres techniques alternatives de protection des plantes basées sur l’utilisation de micro ou macroorganismes peuvent être à l’origine d’inconvénients parfois plus importants que ceux des produits de synthèses qu’ils sont sensés remplacer. Les exemples sont nombreux de pullulations, suite à l’introduction artificielle d’organismes destinés à lutter contre le ravageur.
|
5.2 De la protection raisonnée à la protection intégrée
Au-delà de ces aspects contradictoires, mais également de l’amélioration des techniques de protection des cultures par l’agriculteur à travers une protection raisonnée, le législateur a souhaité faire évoluer encore cette situation en rendant obligatoire la mise en œuvre du concept de production intégrée.
Cela se traduit au niveau européen, à travers l’article 3 de la directive 2009/128/CE et au niveau Français à travers la loi d’Avenir pour l’agriculture de 2014 et sa déclinaison sous le vocable d’Agroécologie.
L’annexe 3 de la directive européenne liste 8 principes sur lesquels repose la production intégrée : prévention, surveillance, raisonnement, méthodes alternatives, réduction des risques et des usages, gestion des résistances et évaluation de la réussite.
La protection intégrée concernant la gestion des bio-agresseurs, en utilisant tous les leviers à disposition de l’agriculteur pour en réduire leurs effets, est un concept qui date des années 1970. Il a été adopté depuis avec un certain succès dans le cas des cultures sous serre et sur certaines cultures spécialisées.
Ce concept a du mal à se développer dans le domaine des grandes cultures car il pose un certain nombre de problèmes aujourd’hui non résolus.
Citons par exemple certaines méthodes alternatives proposées par la directive Européenne et reprises en France dans le concept d’agroécologie.
5.2.1 La rotation des cultures :
1er moyen de lutte prophylactique contre le parasitisme.La rotation des cultures est particulièrement efficace contre le parasitisme inféodé à la parcelle (champignons telluriques comme les sclérotinia, les mildious, l’aphanomyces du pois, le phoma du tournesol, le piétin échaudage des céréales, mais aussi et surtout les adventices et certains ravageurs du sol comme les taupins…). Ainsi les rotations longues avec 5, 6 cultures différentes permettent de réduire globalement le parasitisme. Aujourd’hui l’agriculteur a plutôt tendance à raccourcir ses rotations avec 2, 3 ou 4 cultures différentes pour des raisons économiques. En effet le bilan économique de certaines cultures est supérieur à d’autres à un moment donné et l’agriculteur a plutôt tendance à choisir les cultures présentant un bilan le plus favorable, ce que l’on ne saurait lui reprocher… De même les légumineuses ou l’avoine qui sont d’excellentes plantes de coupure vis-à-vis du parasitisme peuvent poser des problèmes d’écoulement et de commercialisation de la récolte surtout dans les régions sans élevage.
En termes de durabilité, la rotation des cultures est une arme efficace, mais elle atteint vite ses limites compte tenu de l’intérêt de certaines cultures sur le plan économique
5.2.2 Labour, travail superficiel ou non travail du sol ?
Malgré la très grande complexité du sujet (les effets du labour ou de son contraire le non labour dépendent du type de parasitisme, du type de sol du climat et donc de la région…) on peut dire globalement que le labour est une méthode de lutte contre le parasitisme lié aux résidus de culture de surface et aux adventices en particulier.
Son efficacité est faible voire inefficace sur le parasitisme exogène à la parcelle, colonisant la plante vivante. L’autre avantage du labour consiste à créer des conditions permettant un meilleur développement racinaire qui entraîne une meilleure exploration du volume de sol et une plus grande faculté de captage des éléments minéraux.
À l’inverse, le principal inconvénient du labour n’est pas d’ordre parasitaire, bien qu’il perturbe l’équilibre biologique du sol. Il est plutôt d’ordre environnemental dans la mesure où il favorise l’érosion du sol, surtout dans le cas des parcelles en pente et dans les régions à forte pluviométrie.
Pour l’agriculteur l’inconvénient du labour est plutôt d’ordre économique avec un coût important lié au temps de main d’œuvre plus élevé et au coût de l’énergie plus important, nécessaires à sa mise en œuvre.
5.2.3 L’agriculture de conservation :
Les deux paramètres que nous venons d’examiner précédemment constituent le socle de l’agriculture de conservation dont la pratique des Techniques culturales simplifiées (TCS) constitue un des piliers.
Rappelons ici les trois grands principes qui définissent ce système de culture :
- la perturbation minimale du sol (réduire le travail du sol en évitant le labour, jusqu’à la suppression du travail du sol avec la pratique du semis direct),
- des rotations de cultures et de couverts végétaux adaptés (rotations longues).
- la couverture maximale du sol et la restitution des résidus de récolte.
En France ce sont en premier lieu les motivations économiques, gain de temps et économie de carburant, qui ont favorisé le développement de ce type d’agriculture. Mais l’aspect préservation du patrimoine sol (favoriser l’activité biologique et éviter les phénomènes d’érosion) constitue pour un nombre croissant agriculteurs l’élément prépondérant. Néanmoins le véritable semis direct reste rare.
Les pratiques en agriculture de conservation se traduisent par des techniques culturales simplifiées (TCS), avec remplacement du labour par le travail du sol superficiel, ou éventuellement des labours occasionnels. Cette démarche concerne essentiellement certaines grandes exploitations spécialisées dans les cultures annuelles (céréales à paille et colza).
Dans tous les cas, se pose le problème de la maîtrise des adventices qui ne sont plus contrôlées par le labour. Diverses solutions sont mises en œuvre par les agriculteurs, dont la plus fréquente est l’utilisation d’herbicides totaux (Glyphosate) entre deux cultures permettant de détruire les adventices avant le semis sans recourir au labour.
Dans ce cadre l’interdiction du glyphosate, herbicide très peu impactant sur les plans environnemental et santé humaine, serait un non sens.
Il est intéressant de constater ici, que dans le cas de l’agriculture de conservation des sols, la notion de durabilité repose plus sur des aspects patrimoniaux de vie du sol, de fertilité et d’évitement des processus de dégradation, également sur des aspects économiques de viabilité des exploitations et de maintien du tissu social, que sur d’éventuels inconvénients liés à l’utilisation des produits agro-pharmaceutiques.
5.2.4 La gestion des résistances :
Moins de recherche, moins de molécules, moins de familles chimiques à modes d’action différents ont pour conséquence une augmentation des phénomènes de résistance. C’est paradoxalement en augmentant la diversité des moyens de lutte que l’agriculteur s’affranchira de cet effet pervers de la diminution de la lutte chimique. L’apparition des solutions de biocontrôle permettra-t-elle d’éviter ce risque ?
5.3 Le biocontrôle
Le concept de biocontrôle (« biological control » des anglo saxons) est récent. Il englobe la notion plus ancienne de « Protection intégrée » qui connait des applications performantes en productions maraîchères sous abri ainsi qu’en vigne et en arboriculture fruitière.
Mais le domaine du biologique, d’autant plus qu’il s’applique à la protection des plantes, est d’une réelle complexité supposant un très haut niveau de technicité des agriculteurs, ce qui explique en réalité un nombre encore limité de secteurs impliqués.
Le rapport établi par le Groupe de travail de l’Académie d’Agriculture de France (1) : « Biocontrôle en Protection des cultures Périmètre, Succès, Freins, Espoirs », fait un point exhaustif sur le sujet.
Nous en extrayons les principaux éléments qui permettent de comprendre plus aisément les enjeux, espoirs et craintes, de ce concept.
5.3.1 Une tentative de définition :
En 2011, le rapport du député Antoine Herth a défini les produits de biocontrôle comme « un ensemble d’outils à utiliser, seuls ou associés à d’autres moyens de protection des plantes, pour la protection intégrée telle qu’elle figure dans l’approche européenne ». Pour le Club Adalia qui regroupe des techniciens de la protection intégrée, le biocontrôle est « l’ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels. Il vise à la protection des plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel ».
L’Association Française des Fabricants de Produits de Biocontrôle (IBMA) rejoint assez largement cette dernière définition, précisant que les produits de biocontrôle se répartissent en cinq familles : macroorganismes, microorganismes, médiateurs chimiques et attractifs/répulsifs naturels, substances naturelles et tous produits et technologies nouveaux à faible risque.
D’autres définitions, y compris la Loi d’Avenir pour l’agriculture de 2014, s’attachent davantage aux « produits de biocontrôle » plutôt qu’à une véritable mise en perspective de ce qu’est le biocontrôle
5.3.2 Les différents outils du biocontrôle :
L’adoption du biocontrôle par l’agriculteur implique la mise en œuvre successive de trois types d’outils complémentaires et indissociables :
- Choix de cultures et/ou de variétés peu sensibles au parasitisme
- la génétique et l’amélioration des plantes - Favoriser les moyens d’action biologiques préexistant dans l’agrosystème
- auxiliaires, oiseaux…, tout organisme vivant participant à la régulation des bio-agresseurs dans l’agroécosystème - Mettre en œuvre des agents de lutte vivants
- les microorganismes (bactéries, champignons, virus…)
- les macroorganismes (trichogrammes, chrysope, nématodes entomopathogènes…) - Mise en œuvre de moyens de lutte issus du vivant :
- les substances naturelles (extraits de végétaux supérieurs, de champignons…)
- les médiateurs chimiques (phéromones pour piégeage sélectif des mâles ou confusion sexuelle)
- la lutte autocide (perturbation d’une espèce nuisible par introduction massive de mâles stériles issus d’élevages)
- les SDP, Stimulateurs de défense des plantes (substance ou microorganisme vivant ou non, non pathogène, qui appliqué sur une plante, est capable de promouvoir un état de résistance significativement plus élevé face à des stress biotiques (bio-agresseurs), voire abiotiques.
5.3.3 Espoirs et freins du biocontrôle :
On observe aujourd’hui une dynamique positive concernant ces techniques de protection des cultures, qui de plus cadrent bien avec la protection intégrée des cultures, dont la mise en œuvre est rendue obligatoire en Europe depuis le 1er janvier 2014.
Cette dynamique s’exprime à travers :
- une recherche créative stimulée par de nombreux nouveaux acteurs,
- par les investissements récents des grands leaders de l’industrie,
- par un relatif consensus sur le bénéfice environnemental global,
- par un courant sociétal porteur mais parfois peu rationnel.
Parallèlement, des réserves sont exprimées au niveau des agriculteurs qui recherchent des preuves de la valeur de ces solutions avant de les introduire dans leur système de culture et qui s’interrogent également sur les coûts ou les surcoûts engendrés.
L’autre frein au biocontrôle, moins clairement perçu, réside dans la contestation systématique orchestrée autour des techniques d’amélioration végétale et la création de variétés résistantes au parasitisme dont on a vu qu’elles constituaient le principal levier pour la mise en œuvre efficace du biocontrôle.
5.3.4 Le biocontrôle, un mariage de raison avec les outils conventionnels :
Une approche objective de la protection des cultures, plaide aujourd’hui pour une approche diversifiée des moyens mis en œuvre, compte tenu des avantages et des inconvénients des différentes techniques de protection.
Encore faut-il s’extraire de l’idéologie actuelle s’exprimant à tous les niveaux de notre société, laissant croire à d’hypothétiques différences entre chimie de synthèse (les pesticides actuels) et la chimie naturelle (le biocontrôle). Comme par exemple l’idée que les produits de synthèse sont par principe plus dangereux que les solutions dites « naturelles », ce qui apparaît totalement erroné lorsque les critères de mesure de la dangerosité sont appliqués de façon équivalente aux uns et aux autres.
Les produits de protection des plantes de demain :
NB : Il n’y a pas a priori à faire de différences sur chacun de ces critères entre les produits de synthèse chimique et les produits d’origine biologique
|
5.4 L’indispensable levier génétique pour une durabilité des systèmes de production
5.4.1 La création de variétés résistantes au parasitisme, arme n°1 du biocontrôle :
La création de variétés résistantes aux maladies ou aux ravageurs est une méthode de biocontrôle à part entière. Elle a fait ses preuves et elle doit être poursuivie et intensifiée grâce maintenant aux nouveaux outils du domaine des biotechnologies.
C’est à nos yeux dans ce domaine que les synergies les plus fortes et les plus simples à mettre en œuvre, s’exprimeront.
Ainsi la prévention contre le développement des maladies ou des ravageurs grâce à la création de nouvelles variétés résistantes et adaptées au contexte agro-climatique constitue un des moyens les plus efficaces de réduire l’utilisation des pesticides qu’ils soient d’origine chimique ou naturels.
5.4.2 Des OGM partout dans le monde, mais pas en France :
Des plantes génétiquement modifiées comme le maïs Bt, ainsi nommé parce qu’il exprime une des toxines « Cry » de la bactérie Bacillius thurigiensis. Ce qui lui permet d’éviter les attaques de la pyrale Ostria nubilalis, de la noctuelle Sesamia nonagrioïdes, de la Chrysomèle Diabrotica virgifera virgifera en zones tempérées et celles des Noctuelles du genre Héliotis en régions chaudes. Les variétés ogm de maïs Bt sont aujourd’hui abondamment cultivées à travers le monde depuis de nombreuses années (37 % des surfaces OGM cultivées soit près de 70 millions d’ha en 2017) sans manifester d’inconvénients particuliers ou supplémentaires, quels qu’ils soient, par rapport aux variétés traditionnelles.
Malheureusement, en Europe et tout particulièrement en France, des accusations ne reposant pas sur des bases scientifiques, mais savamment entretenues par une idéologie dominante font que ces techniques ne se sont pas développées.
5.4.3 Les NBT (New Breeding Techniques), l’« Edition de gènes » et le système CRISPR/Cas9
Les premières variétés transgéniques ont été commercialisées il y a 20 ans. On connaît leur succès hors Europe (185 millions d’ha cultivés en 2016). De nouveaux outils apparaissent (les NBT - New Breeding Techniques), en particulier « l’édition de gènes », qui a l’avantage d’être peu onéreuse, beaucoup plus précise et permet de raccourcir considérablement la durée de création d’une variété.
C’est aujourd’hui à notre sens, le levier le plus important et le plus abouti qui peut permettre de créer des variétés adaptées à une AGRICULTURE DURABLE et PERFORMANTE, qu’elle soit biologique, agroécologique ou conventionnelle…
Parmi ces nouveaux outils d’édition de gènes, le système CRISPR-Cas9 est le plus prometteur. C’est à l’origine un mécanisme de défense immunitaire développé par certaines bactéries pour lutter contre l’invasion d’ADN exogène, principalement des virus. La protéine Cas9 est utilisée pour induire des cassures précises dans l'ADN. Ces ruptures peuvent conduire à l'inactivation d’un gène existant ou à l'introduction de gènes pouvant être soit une version allélique d’un gène qui vient remplacer l’allèle existant, soit un transgène apportant un nouveau caractère.
En d’autres termes, ces techniques ne nécessitent plus obligatoirement, ni l’insertion de matériel génétique externe, ni de passage de barrière entre les espèces en particulier, point commun avec la mutagénèse utilisée depuis couramment depuis plusieurs décennies.
Le système CRISPR/Cas9 a déjà été appliqué à une large gamme d’espèces végétales. On compte ainsi, des tolérances aux maladies comme à l’oïdium chez le blé (Wang et al., 2014), au feu bactérien chez le riz (Zhou et al., 2016) et à des virus chez le concombre (Chandrasekaran et al., 2016), et des modifications de profils de maturation chez la tomate (Ito et al., 2015). Dans le futur, de nombreuses autres applications pourraient voir le jour, tels des tolérances aux stress abiotiques (sécheresse, salinité, température…), des facteurs de qualité améliorés (composés nutritionnels).
|
Une question de réglementation cruciale pour les agriculteurs : Les NBT permettent d’obtenir des plantes améliorées sans introduire de gènes étrangers à l’espèce et ne sont donc pas « transgéniques ». Les plantes issues de ces nouvelles techniques ne se distinguent pas des variétés obtenues par des méthodes de sélection classiques comme la mutagenèse. Sous la pression de groupuscules et d’ONG anti OGM, les politiques et les instances Européennes ne cessent de repousser la révision de la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. De nombreux scientifiques s’accordent pour dire que seuls les OGM (plantes contenant une nouvelle combinaison de matériel génétique par insertion d’ADN recombinant) tombent dans le champ de la Directive, alors que les autres plantes doivent pouvoir être développées dans les mêmes conditions que les plantes issues de la sélection végétale conventionnelle. Aujourd’hui l’objectif de ces « militants écologistes » est de faire assimiler les NBT en général aux OGM en particulier. C’est ainsi que se sont une nouvelle fois déployés des saccages de parcelles de Tournesols et de Colza rendus tolérants aux herbicides par mutagénèse (VrTH), au cours de cet été à Gardouch (31) et ainsi que sur des plateformes d’essais de la coopérative Dijon Céréales. Soutenir ces actes de vandalisme et cette idéologie au niveau politique serait une incohérence supplémentaire au regard de la promotion de systèmes de cultures agroécologiques moins consommateurs de pesticides. Cette politique priverait tous les agriculteurs du principal outil agronomiquement et économiquement nécessaire au développement souhaité par ailleurs, de nouveaux modes de culture.
|
5.5 Conclusion : Pas de durabilité ni de protection des cultures efficace sans une utilisation diversifiée et simultanée de tous les moyens de lutte
Une très grande majorité des agronomes lucides s’accorde pour dire que dans les décennies qui viennent, il faudra produire plus et mieux. Le produire plus est essentiellement une affaire de génétique et d’amélioration des variétés cultivées autant qu’une affaire de protection des cultures contre ses ennemis en perpétuelle évolution. Le produire mieux est également une question de génétique et de création de variétés plus tolérantes aux divers parasitismes. Mais cela ne suffira pas, il faudra impérativement conserver des outils de protection des plantes efficaces et économiquement rentables, que ce soit des produits de nature chimique ou biologiques. Ces outils devront être irréprochables sur le plan de leur impact sur l’environnement ainsi que sur le plan de leur impact sur la santé humaine, qu’ils soient d’origine chimique ou biologique.
Ces principaux éléments de lutte directe doivent bien sûr s’intégrer dans une démarche raisonnée économiquement, qui prend en compte en particulier les aspects rotations et les techniques culturales, constituant la base de ce que constitue la protection intégrée et de ce que devrait être l’agroécologie.
Références bibliographiques
- La protection sanitaire des cultures : un facteur essentiel pour satisfaire les besoins alimentaires et énergétiques d’une population mondiale en constante augmentation
– Ch. Descoins, Directeur honoraire de recherche à l’INRA – Octobre 2013 - SNPJ - Le système CRIsPR/Cas 9 Pour La compréhensIon du vivant et l’InnovatIon variétale
- Cécile Collonnier, Ingénieur agronome – INRA Versailles – dec 2016 - Revue de l’Académie d’agriculture N°8 – Dossier Bonnes pratiques phytopharmaceutiques
- Académie d’Agriculture de France : Le biocontrôle en agriculture
– Groupe de travail coordonné par Jean Louis Bernard – Février 2017 - Académie d’Agriculture de France - Science et protection intégrée des plantes cultivées – JL. Bernard, 28 octobre 2013
- AFBV Biotechnologies végétales infos n°8 – Mars 2016
- Réduction des phytos, une transition engagée mais de longue haleine
- Jean Paul Bordes, in ARVALIS-infos.fr du 8 février 2018
| Biodiversité et Durabilité
Ce mot que nous lisons fréquemment dans la presse finit par ne plus avoir un sens très clair. Telle mesure qui est dite bonne pour la biodiversité est considérée comme ayant obtenu son certificat de recevabilité dans le monde de l’écologie correcte. « Favoriser la biodiversité » consiste à augmenter la capacité d’un milieu à abriter la vie d’espèces animales et végétales nombreuses et variées. Il est, nous semble-t-il, légitime de se poser la question de savoir s’il suffit que la biodiversité d’un milieu soit accrue pour qu’il soit automatiquement amélioré. La biodiversité est composée d’espèces et de variétés dont certaines peuvent être les bienvenues et d’autres moins. Les vipères, les tiques, les moustiques, les rats, les bactéries, les virus, les chardons, le vulpin, le chiendent, la cuscute, l’ensemble des agents pathogènes des animaux et des végétaux font partie de la biodiversité, doit-on admettre qu’un milieu qui favorise leur prolifération soit considéré comme écologiquement en progrès ? Pour nous, la réponse est clairement NON ! Certains vont jusqu’à considérer que l’homme est de trop dans les écosystèmes. Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous avons pris nettement le parti que pour être considérée comme positive, l’évolution de la biodiversité doit aller dans le sens de la sécurité, de la santé et du confort de l’homme et de son activité. Honni soit qui mal y pense.
|
|
Désinformation complète du grand public par la presse :
Ces deux exemples sont représentatifs de milliers d’autres qui, quotidiennement abreuvent le lecteur citoyen et consommateur. Une telle manipulation explique en grande partie le décalage important entre les efforts quotidiens de l’agriculteur pour aller vers une agriculture durable et la vision pessimiste du grand public qui s’éloigne, avec une demande sociétale de plus en plus décalée.
|
Conclusion
« Rare destin pour un mot que d’avoir une existence avant d’avoir un sens » !
Cette maxime s’applique parfaitement aux termes : durable et durabilité. Comme d’autres, ces mots sont en embuscade et permettent des lectures de la réalité sur un spectre infini. Leur plurivocité autorise chacun à leur faire dire ce qu’il veut. Au mieux leur tentative de définition reste confinée au domaine de l’incantation.
L’analyse que nous avons faite de la durabilité en agriculture, montre que les choses sont loin d’être simples et univoques. L'examen des pratiques agricoles actuelles, à travers quelques sujets d'importance cruciale comme l'énergie, l'eau, le capital sol et la protection des cultures, nous conduit à penser que les agriculteurs sont au cœur des processus qui tendent à inscrire leur métier dans la durabilité.
L'ensemble des sujets et des questions abordées montre que l'activité agricole concourt dans la majorité des cas à préserver un équilibre entre la société, l'économie et l'environnement, tel que nous l'avons défini en préambule.
Il semble absurde, en ce début de 21ème siècle, de décréter l’état d’urgence pour une agriculture qui s’est depuis toujours adaptée aux besoins de l’homme, faisant ainsi la preuve qu’elle est parfaitement durable. L’évolution et le changement ne se décrètent pas, surtout dans l’urgence, d’autant plus que les évolutions souhaitées sont parfois douteuses lorsqu’elles nous ramènent à un passé dont les hommes et les agriculteurs ont eu bien du mal à s’extraire. Les différentes voies empruntées par les producteurs de grandes cultures, les éleveurs, ou en productions spécialisées comme le maraichage, l'arboriculture ou la viticulture visent à répondre à des stratégies économiques, des choix politiques, de nouvelles demandes de la société que ce soit en termes de santé, d'emploi ou de protection de l'environnement.
Nous avons essayé, en agronomes, de balayer les principales composantes des systèmes agricoles en tentant d’analyser leurs effets sur la durabilité. Si l’on reprend ce concept dans son entière acception (agronomique, sociale et économique) force est de constater que contrairement à ce qu’une certaine idéologie imagine, c’est bien la démarche découlant des systèmes de culture tels qu’ils se pratiquent aujourd’hui, notamment en France et en Europe, qui nous semble la plus durable :
- à moins de maintenir une sous population agricole dans un état de dénuement avancé, ou d’assumer une augmentation des prix agricoles incompatible avec le marché mondialisé, les propositions prônant actuellement la réduction des facteurs de production sans en préciser le point de départ, ou l’évitement des innovations dans les domaines de la génétique, de la nutrition et de la protection des plantes ne nous paraissent pas adaptés
- l’augmentation de la population mondiale, l’augmentation inéluctable des importations des pays du Maghreb à nos portes, la fertilité de nos sols et la climatologie favorable de la géographie française, sont autant d’éléments justifiant une agriculture ouverte sur le monde plutôt qu’une agriculture refermée sur elle-même ou sanctuarisée pour une élite.
- les griefs adressés à l’encontre de l’agriculture actuelle, vis-à-vis de son effet sur l’environnement, vis-à-vis de la qualité de l’alimentation qui en découle, ne résistent pas à une analyse sérieuse non pas des dangers, mais des risques, pour certains réels mais mineurs, et pour bien d’autres, perçus donc inexistants.
Malheureusement, le niveau et la tonalité de l’information actuels, jouant essentiellement sur les deux leviers de la peur et de l’émotionnel, finissent par faire croire à ce qui n’est pas. Ce phénomène s’impose d’autant plus dans le domaine agricole que le nombre des agriculteurs s’est considérablement réduit et que dans le même temps, la société et le consommateur en particulier, s’étant urbanisé ou rurbanisé, s’est éloigné des réalités d’une activité qu’il croit toujours connaître mais ne connaît plus.
Certes, des progrès restent à faire, qu'il s'agisse de la production et la consommation d'énergie, la gestion de l'eau, la préservation des sols, la protection des cultures. Néanmoins, l'évolution des pratiques telle que nous la décrivons ici et dans plusieurs articles diffusés sur notre site, s'inscrit volontairement dans la recherche d’un nouvel équilibre pour une agriculture durable.

 composition, son comportement face aux aléas climatiques ou aux pratiques culturales (capacité à alimenter les plantes en eau et éléments nutritifs, stabilité, tassements, battance...), ou encore sa biodiversité, mais également une éventuelle dérive du parasitisme transmis aux cultures (maladies telluriques, ravageurs, adventices) etc… Les délais pour mesurer des évolutions possibles d’un sol constituent une autre gamme de critères, sachant que les évolutions décelables sont parfois très lentes de l’ordre de plusieurs décennies voir de plusieurs siècles (par exemple pour le taux de matière organique suite à des modifications des pratiques culturales).
composition, son comportement face aux aléas climatiques ou aux pratiques culturales (capacité à alimenter les plantes en eau et éléments nutritifs, stabilité, tassements, battance...), ou encore sa biodiversité, mais également une éventuelle dérive du parasitisme transmis aux cultures (maladies telluriques, ravageurs, adventices) etc… Les délais pour mesurer des évolutions possibles d’un sol constituent une autre gamme de critères, sachant que les évolutions décelables sont parfois très lentes de l’ordre de plusieurs décennies voir de plusieurs siècles (par exemple pour le taux de matière organique suite à des modifications des pratiques culturales).